
Penser la nature – d’après l’œuvre de Virginie Maris 21 Mar 2022
Penser la nature est une mini-série en 4 épisodes consacrée au concept de nature, d’après l’œuvre de Virginie Maris : La part sauvage du monde

Rappelons quelques faits. 200 espèces sont détruites chaque jour. Les animaux sauvages, les oiseaux, les insectes sont massivement exterminés. L’océan est envahi par les déchets, la moitié des rivières sont mortes. En 2050 il n’y aura plus aucun poisson dans l’océan. 97 % des forêts anciennes ont disparu. Au rythme actuel de destruction il ne restera bientôt plus un seul espace de nature sauvage. Nous devons arrêter tout ça, vite. Nous devons défendre l’environnement. Non, nous devons défendre la nature, ou alors le vivant ? Euh non, la biodiversité ! Non, attendez, en fait c’est pas ça, nous nommes la nature qui se défend, ou plutôt qui contre-attaque ! Ah mais attendez si nous sommes la nature, pourquoi on la défendrait contre nous-même ? Ça n’a pas de sens… Bon c’est le bazar, c’est confus, je pense qu’on a besoin de décortiquer tout ça.
1. QU’EST-CE QUE LA NATURE ?
Pourquoi parler de nature ?
Voici donc une série d’articles-podcasts consacrés au concept de nature. Deux principales raisons m’ont motivé à travailler sur cette présentation.
Bataille culturelle
Premièrement, notre résistance opère sur deux fronts, matériel et culturel. Non seulement nous visons les infrastructures et institutions détruisant la planète, mais nous combattons la culture justifiant ces exploitations et destructions. L’idée de nature et de sa préservation est un point crucial de cette bataille culturelle.
Écologie : nature et liberté
Deuxièmement, l’écologie selon Bernard Charbonneau « ne défend pas la nature ou la liberté, comme seraient tentées de le faire sa droite naturaliste ou sa gauche gauchiste, mais la nature et la liberté. » Ces deux questions profondes, la nature et la liberté, nous animent, nous passionnent, et nous poussent à l’action. Sur Floraisons, on a récemment analysé le concept de liberté avec Aurélien Berlan, je me suis dit qu’il était temps, pour équilibrer, d’explorer celui de nature.
Contre l’habitation totale
C’est pourquoi je vais dorénavant vous parler d’un livre que j’ai eu plaisir à étudier, La part sauvage du monde, écrit par Virginie Maris et publié en 2018 au Seuil. Virginie Maris est philosophe de l’environnement au CNRS et travaille au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. La part sauvage du monde m’a aidé à y voir plus clair sur toutes ces questions. Je vous propose ici un résumé de ses principaux argument.
Interagir avec le monde vivant sans domination ni destruction est nécessaire, mais pas suffisant. Les humains partagent la Terre avec d’innombrables autres vies, certaines acceptent la cohabitation, d’autres n’en ont pas la moindre intention. Nous ne sommes pas chez nous partout. Virginie Maris va donc plus loin que les appels à la simple cohabitation, elle livre un plaidoyer contre l’habitation totale, pour la limitation de notre territoire. Pour cela, elle désire réhabiliter un mot : la nature.
Avertissement
Par honnêteté, je précise qu’il s’agit bien entendu de ma lecture personnelle de cet ouvrage. J’y puise énormément et pour des raisons pratiques, je choisi de ne pas distinguer clairement les citations du livre et mes ajouts dans cette présentation. J’espère faire honneur à la pensée de Virginie Maris, sans pour autant prétendre à une représentation fidèle.
Ma présentation s’inspire du livre et se divise en 4 parties. Dans la première, on va voir quelques définitions. Ensuite on examinera l’évolution historique du concept de nature. Dans la troisième partie on analysera comment la nature est absorbée jusqu’à disparaître. Et enfin on réfléchira à un concept de nature utilisable par le mouvement écologiste aujourd’hui.
Un concept qui disparaît…
Le concept de nature a une histoire riche et complexe, mais il tend aujourd’hui à disparaître en même temps que la réalité qu’il désigne. On a cessé de parler de “nature” pour parler de “biodiversité” puis de “services écosystémiques”. Les protecteurs de la nature ont eux-mêmes délaissé ce mot et aujourd’hui on nous annonce carrément “la fin de la nature”.
…mais la nature demeure
Pourtant, les plantes continuent de pousser avec le soleil, les loups chassent en meutes, les humains ont toujours besoin d’air, d’eau, de nourriture, de repos et d’amitié. La nature est toujours là, mais c’est surtout la nature indocile, sauvage, qui va nous intéresser ici. La part sauvage du monde, c’est les animaux non domestiqués, les terres non productives, les lieux, les êtres et les processus qui échappent au contrôle.
Définitions
Nature : trois sens différents
Le mot “nature” comporte trois sens différents, on va commencer par les distinguer :
- La nature-totalité. La nature, c’est tout. Tout ce qui a été, est et sera. Ce sens est peu utilisé.
- La nature-normalité. C’est “naturel” signifie qu’une chose est normale (c’est comme ça qu’elle doit être), ou ordinaire (elle fonctionne comme il faut).
- La nature-altérité. C’est “la part sauvage du monde”, celle que nous n’avons pas créée. La nature s’oppose ici aux humains, à la culture ou à l’artifice.
Nature : étymologie
L’étymologie du mot nature est belle et intrigante. Dans la plupart des langues occidentales, le concept de nature est basé sur le mot latin natura, le participe futur du verbe “naître” au féminin. En Français, on pourrait le traduire par “bientôt naissante”. Le mot “nature” présente ainsi deux qualités :
- l’idée de processus : une force, une potentialité ;
- l’idée d’autonomie : quelque chose qui se déploie par elle-même, portant en elle son propre principe.
Le concept de nature qualifie donc une idée de force autonome, ne dépendant pas de nos représentations.
Confusions et ambivalences
Confusion entre normalité et altérité
Nature-normalité et nature-altérité sont souvent associées ou confondues : les activités humaines sont en général considérées comme perturbant le fonctionnement naturel des écosystèmes. Ce raisonnement est peu pertinent puisqu’il associe influence humaine et perturbation. C’est une source de confusion et voilà pourquoi il est très important de définir à quoi fait référence le mot nature/naturel quand on l’emploie : à la part sauvage du monde (altérité), ou à un fonctionnement normal (normalité). Tout au long de cette présentation, c’est à la nature-altérité que je fais référence.
Néanmoins, cela n’empêche pas de reconnaître l’immense capacité des humains à bouleverser leur environnement. Partout sur la planète, le contact d’Homo sapiens avec les autres espèces a montré à quel point l’humain peut être destructeur (par exemple par l’extermination des grands animaux). L’arrivée des humains a généralement pris la forme d’un bouleversement des équilibres écologiques. Ce pouvoir de destruction n’a fait que s’amplifier avec la démographie et les progrès techniques.
Confusion entre totalité et altérité
À celles et ceux qui veulent protéger la nature, on répond parfois que l’humain fait partie de la nature, donc les activités humaines sont forcément naturelles et ne peuvent pas lui nuire. Défendre la nature contre elle-même serait donc absurde… Il s’agit d’un sophisme qui joue sur la confusion entre nature-totalité (la nature c’est tout) et nature-altérité (la part sauvage du monde). En réalité, vouloir préserver la nature-altérité, c’est protéger quelque chose de l’influence humaine.
Au-delà de ces confusions communes, il est bon de rappeler que pendant 99,99 % de l’histoire de la vie sur Terre, avant l’arrivée des humains, les trois sens (totalité, normalité, et altérité) étaient en quelque sorte superposés : le “grand tout”, l’intégralité du monde, était sans trace de culture humaine, sauvage, et c’était normal.
Un terme traversé d’ambivalences
Le terme de nature semble presque toujours traversé de courants contraires. Deux figures de la nature coexistent depuis l’Antiquité : ordre/chaos, sublime/ordinaire, généreuse/ingrate, admirable/terrifiante. De plus, alors que la nature est définie comme opposée aux activités humaines, elle se retrouve paradoxalement au centre de ces activités (sciences, morale, arts). Elle est par excellence l’objet d’étude, de connaissance, de réflexion, de contemplation et d’inspiration. Certes, toutes ces ambivalences ne simplifient pas les discussions, mais elles sont aussi le signe d’une richesse, d’une notion profonde et fascinante, reflétant notre rapport au monde, à la confluence de toute ce qui fait une vie proprement humaine.

2. Histoire et fin de la nature
Dans cette deuxième partie, on va examiner l’histoire et la fin du concept de nature. Mais avant toute chose, on doit parler du grand partage. Dans la première partie, on a défini la nature comme nature-altérité, c’est-à-dire comme opposée aux humains, à la culture, à l’artifice. Cette définition sous-entend forcément un grand partage, une séparation entre les humains et leur production d’un côté, le monde naturel de l’autre. La substance de ce partage, de cette frontière, de cette relation entre nature et culture, c’est un point central du livre de Virginie Maris. Et pour rentrer dans le cœur du problème, il nous faut examiner une idée importante : celle qui fait du grand partage le grand responsable du désastre.
Grand partage, grand coupable
C’est en effet une critique notoire du grand partage, il serait à la racine de la crise environnementale. Pourquoi et comment ?
La pensée occidentale moderne construit un dualisme en deux étapes :
- On opère un grand partage nature/culture en reconnaissant une altérité radicale du monde naturel.
- On établit et on justifie ainsi une hiérarchie entre les deux, une supériorité de la culture sur la nature, des humains sur les non-humains, etc. à partir de cette distinction. On peut ainsi justifier la domination et l’exploitation de la nature par les humains.
Le partage entre nature et culture mènerait invariablement – nous dit-on– à une hiérarchisation des deux parties. On ne peut pas faire autrement. Il faudrait donc sortir de cette dichotomie, ne plus séparer les humains et la nature, adopter au contraire une vision du monde intégrative qui mettra un terme au désastre écologique – en tous cas on l’espère. Mais est-ce bien justifié ?
Ce n’est pas ce que l’histoire confirme. Premièrement, l’idée de nature-altérité n’implique pas nécessairement son appropriation et sa destruction. Deuxièmement, l’idée de continuité n’a pas empêché la “grande accélération” du développement. Par ailleurs, attribuer la catastrophe écologique au dualisme de la civilisation occidentale, c’est passer sous silence les dynamiques et rapports de force qui la sous-tendent, les moyens matériels, la puissance de destruction des outils. Examinons plus en détail l’histoire du concept de nature.
Histoire de la nature
La nature est un concept construit dans la culture et le langage et dont le contenu varie. Virginie Maris ne cherche pas à en faire une généalogie complète, limitant ses recherches historiques à la conception de la nature comme “part sauvage du monde” en Occident.
Antiquité : invention de la nature
C’est Aristote qui fait se détacher la nature comme entité autonome. Pour lui, elle est un ensemble de phénomènes liés par des lois qui leur sont propres, séparés des affaires humaines, valant par eux-mêmes.
Christianisme : nature à craindre
Avec le christianisme, le dogme d’une séparation stricte entre dieu et nature s’impose. L’humain est situé entre les deux. Son âme le relie à dieu, sa matérialité à la nature. Au Moyen âge, la nature est ainsi perçue comme un instrument divin, inférieure et dégradée. Toutefois, dans cette conception, la nature conserve une part d’autonomie et de mystère. Elle échappe à l’humain, elle est donc une puissance à craindre.
Époque moderne : nature à dominer
À l’époque moderne, l’idée de nature est vidée de toute autonomie. Pour Descartes, les animaux sont comme des machines, des automates faits de rouages et de ressorts. Afin d’améliorer la destinée humaine, il faut connaître les secrets de la nature grâce à la science, l’asservir et la contrôler grâce à la technique. La nature est ainsi radicalement instrumentalisée et asservies aux finalités humaines – des hommes blancs en particulier.
À partir des différences, les modernes établissent des hiérarchies. On verra les mécanismes du dualisme dans la dernière partie. Cette vision du monde connaît un succès fulgurant, probablement parce qu’elle vient renforcer et justifier les hiérarchies existantes.
Romantisme : nature à admirer
Au 18e siècle, le romantisme est une réaction au rationalisme des modernes. Contre l’avènement du capitalisme et la réduction mécaniste du vivant, le romantisme est intimement lié à l’idée de nature, et l’investit de valeurs inédites. La nature devient une force puissante, sublime, exaltante. Elle gagne en grandeur mais elle perd en altérité, puisqu’elle sert d’écran de projection narcissique aux valeurs humaines.
19e siècle : nature à intégrer
Au 19e siècle, la théorie de l’évolution par sélection naturelle à un impact considérable sur l’idée de nature-altérité.
- Histoire : La nature n’est plus immuable, elle a sa propre histoire et n’a pas été créé par dieu pour les besoins des humains.
- Continuité : Les être humains sont issus du même processus d’évolution que les autres espèces, ils ne sont ni exceptionnels ni supérieurs.
- Interdépendance : Les êtres vivants sont en interaction avec les autres organismes, y compris les humains.
Aujourd’hui : nature à protéger
La conscience que les activités humaines exercent une pression sur les milieux naturels n’est pas nouvelle. Ces risques sont étudiés dès le 18e siècle, mais n’ont pas d’effet politique. Au début du 19e siècle, il devient difficile d’ignorer les innombrables destructions causées par le développement industriel sur l’humanité et la nature. La nature, alors perçue comme vulnérable, doit être protégée des assauts de la modernité. Dans les années 1980, le terme “biodiversité” va progressivement remplacer toute référence à la nature dans le monde scientifique, politique et militant. La protection de la nature suit aujourd’hui trois approches :
- Le préservationnisme : romantique, il entend limiter l’emprise et les interventions humaines sur la nature sauvage. Il se manifeste par la création de parcs et réserves naturelles sur des sites jugés remarquables.
- Le conservationnisme : utilitariste et instrumental, il entend gérer les ressources naturelles et préserver leur capacité de régénération afin de les exploiter le plus longtemps possible, de façon optimale. Il se manifeste notamment par l’institution de “bonnes pratiques” quant au prélèvement des ressources grâce à des quotas et des moratoires.
- La conservation de la biodiversité : une approche scientifique centrée sur la biodiversité. Il ne s’agit pas de savoir si les humains influencent un site ou surexploitent des ressources, mais s’ils contribuent ou empêchent le maintien de la diversité du vivant.
Le problème du grand partage
Dans la théorie, le grand partage reste un élément central de la pensée moderne. Une critique évidente qu’on peut faire à ce grand partage, c’est que dans la pratique, on est très loin d’un partage absolu entre nature/culture, naturel/artificiel, etc. En réalité, nature et culture sont inextricablement liées. Le rapport avec le monde naturel est profond et complexe, parfois très instrumental et parfois pas du tout.

La nature influence la culture
Dès la préhistoire, les cultures se sont développées différemment selon leur environnement ; ce dernier influence l’organisation sociale, la répartition des tâches, le niveau de coopération entre individus, les trajectoires de domestication, les mythes, les arts etc.
La culture influence la nature
Inversement, les activités humaines ont une influence significative sur le fonctionnement des écosystèmes : presque partout où ils s’installent, les humains jouent un rôle d’“espèce clef de voûte”, c’est-à-dire dont l’effet sur l’environnement est disproportionné au regard de sa population.
Glissement anthropocentriste
Plus que deux mondes complètement étanches, nature-altérité et activités humaines présentent un spectre de relations et d’agencements différents. Mais que se passe-t-il si on abandonne totalement le concept de grand partage ? Si on suit ce raisonnement, la question ne serait alors plus de préserver une nature sauvage intacte (qui n’existerait pas), mais de mettre en place des relations favorables aux humains et à la nature, notamment en se focalisant sur la biodiversité : ce qui est bon pour la nature est ainsi bon pour les humains. Protéger la nature revient à nous protéger nous-mêmes, puisqu’elle nous rend des “services écosystémiques”. Ce glissement anthropocentriste pose cependant de sérieux problèmes.
Insister sur l’intégration des humains dans la nature fait de celle-ci le milieu des humains et nous fait perdre la capacité de reconnaître et défendre son altérité. Que faire des nombreux conflits entre les intérêts des humains et des autres espèces ? Comment justifier que certains lieux demeurent sauvages, hostiles, inhabités ? Au nom de quoi poser des limites à l’empire humain si l’altérité de la nature n’est pas reconnue ? On en arrive à une véritable fin de la nature.
La fin de la nature
Le concept d’Anthropocène
Le terme “Anthropocène” a été utilisé pour la première fois par Paul Crutzen pour proposer un nouvel âge géologique, “l’Ère de l’humain”, pour la période dans laquelle l’impact des influences humaines devient significatif à l’échelle de l’histoire de la Terre. Cette conception pose de nombreux problèmes fondamentaux, en voici quatre :
- Si l’influence des humains est présente sur toute la planète, alors la nature-altérité n’existe tout simplement plus et on en revient aux questions précédentes.
- L’Anthropocène nous parle d’un système Terre observé de l’extérieur, déconnecté des dynamiques du vivant, de l’action politique, des choix.
- L’impact sur la nature est très globalement attribué au destin commun de l’espèce humaine dans son ensemble, invisibilisant les multiples rapports de forces, les groupes, les sociétés, les États qui ne contribuent pas également au désastre écologique, ni n’en subissent les effets de la même façon. Le pouvoir est donc effacé du récit.
- Le désastre écologique y est appréhendé, via des courbes et des graphiques, comme un problème d’ordre techno-scientifique qui doit être résolu par les ingénieurs et les scientifiques grâce à une gestion globale – par exemple l’ “optimisation du climat” grâce à la géo-ingénierie à large échelle.
Fin de la société
L’Anthropocène n’est pas seulement un concept, il est un programme de contrôle à grande échelle du système Terre. C’est “un paradigme déguisé en époque”, un projet politique de gestion du désastre par une gouvernance mondiale, un règne des experts au service de la civilisation industrielle. C’est un problème de taille pour le mouvement écologiste puisqu’il s’attaque à la fois à la nature et à la liberté, qui nous sont chères.
En désignant la gestion globale de la planète et de celles et ceux qui la peuplent comme solution au désastre, le programme Anthropocène évacue la question politique et sociale, et appelle une oligarchie technocratique, une tyrannie d’experts et de décideurs à l’échelle planétaire.
Fin de la nature
Selon les mots de son inventeur : « Les vieilles barrières qui séparaient la nature de la culture s’effondrent. Ce n’est plus nous contre la “Nature” mais nous qui décidons ce qu’est la nature et ce qu’elle deviendra […] Dans cette nouvelle ère, la Nature, c’est nous. » La nature est réduite à une simple chose sans pouvoir ni autonomie. L’éco-charlatan Bill McKibben va même jusqu’à déclaré en 1989, « la nature est morte ». La question est ainsi réglée une bonne fois pour toute, c’est aux humains d’en prendre les commandes dans un narcissisme, un égocentrisme décomplexé.
Annoncer “la fin de la nature”, c’est assumer sa liquidation, l’artifice total. La nature est morte donc tuons la nature !
Dans cette mouvance, on retrouve Bruno Latour, et Philippe Descola, pour qui carrément « la nature n’existe pas ». Certes, son travail nous invite à ne pas universaliser le concept de nature-altérité, mais je me demande ce que concrètement ça apporte à notre résistance face à la destruction de la nature, si on ne peut plus nommer la nature, on ne peut plus nommer sa destruction. Et concrètement, “nature” est remplacé par des termes beaucoup moins intéressants comme “le vivant”. Mais que signifie vivant ? Là aussi on a des chimistes pour nous assurer que « la vie en tant que telle n’existe pas, personne ne l’a jamais vue… » (Albert Szent-György, cité par Bertrand Louart dans Les êtres vivants ne sont pas des machines).
Comment résister dans ces conditions ? Par ailleurs les plantations c’est du vivant, les OGM c’est du vivant, la vie domestiquée c’est du vivant, qu’est-ce que ça apporte ? Utiliser ce mot revient abandonner les valeurs et qualités associées au concept de nature qu’on essaye justement de défendre ici.
Fin de la préservation
Et enfin, si la nature est morte, à quoi bon la protéger ? La nature protégée par les parcs est loin d’être “vierge”, intacte de toute influence humaine. Pourquoi donc préserver une nature fantasmée, qui de toutes façons n’existe plus ? La “fin de la nature” permet de se débarrasser de celles et ceux qui refusent le projet de domestication totale du monde, ainsi que de la conservation traditionnelle jugée anachronique, coûteuse et contre-productive. L’heure est à la gestion de l’environnement, au développement économique au nom du “bien-être” humain.

3. Absorptions de la nature
Comme évoqué précédemment l’idée de continuité nature-culture n’a pas empêché la “grande accélération” du développement. Pour le dire autrement, au petit jeu de ne plus partager, de ne plus séparer nature et culture, c’est la nature qui y perd, ensevelie sous la culture.
Pour mieux tuer la nature, on déclare qu’elle n’existe pas. On peut ainsi, la conscience tranquille, intensifier le développement de la civilisation industrielle, son extension mondiale par la colonisation, et la globalisation culturelle et économique. Ce développement se heurte néanmoins à des obstacles, parmi lesquels, les aires de protection des milieux naturels. Ces dispositifs cherchent à restreindre l’emprise des humains sur les territoires. Quelques îlots de nature sont ainsi restés relativement sauvages, préservés de la domination humaine, servant de refuges à une grande diversité d’espèces et d’individus. La conservation constitue un des derniers remparts, à l’assujettissement total du monde.
Mais les discours de l’Anthropocène ont décrété cet effort vain. Dans l’ère de l’humain, il ne s’agirait plus de limiter les influences, mais de les piloter savamment. Nous allons voir comment la conservation, au lieu de continuer à protéger l’existence d’une nature-altérité, risque à présent de contribuer à sa dissolution par trois phénomènes d’absorption : technique, économique, bureaucratique.
Absorption technique
Au début des premières réserves naturelles du 20e siècle, on pouvait distinguer deux approches :
- Le conservationnisme ressourciste : préconisant une gestion active afin de maximiser l’utilité des milieux naturels pour les humains.
- Le préservationnisme : préconisant l’absence d’intervention pour laisser libre cours aux processus naturels.
Aujourd’hui, la convergence entre les fins et les moyens est ébranlée. L’approche ressourciste peut très bien s’accommoder du laisser-faire s’il est plus efficace que l’intervention, tandis que la préservation peut chercher à intervenir fortement afin de restaurer, mimer ou recréer la nature.
Très variables selon les contextes culturels et écologiques, les projets de préservation actuels se distinguent toutefois de l’agriculture ou de l’aménagement du territoire par la volonté de protéger, conserver ou restaurer une certaine biodiversité ou des écosystèmes, indépendamment des usages qu’on peut en faire. Lorsqu’on souhaite conserver la biodiversité, il faut préciser quelle(s) dimension(s) de biodiversité exactement, car elles ne se superposent pas toujours. Cela peut par exemple concerner les espèces ou les habitats. On va voir dans ces deux cas à quel point la technique brouille la distinction entre naturel et artificiel.
Protection des espèces
Le maintien de populations nécessite une qualité des habitats et une diversité génétique suffisante. Plusieurs objectifs peuvent être recherchés :
- éviter l’extinction ;
- assurer la persistance ;
- maintenir un potentiel d’évolution ;
- restaurer une abondance historique.
À cette fin, plusieurs moyens de protection peuvent être mis en œuvre :
- interdiction ou diminution du prélèvement ou des dérangements ;
- construction d’îlots de reproduction ;
- contrôle des prédateurs et concurrents ;
- transferts de certains individus ;
- réintroduction d’espèces disparues localement de leur habitat naturel ;
- relocalisation face à l’évolution du climat ;
- technologies de reproduction, insémination artificielle, fécondation in vitro, “résurrections d’espèces” par clonage, banques de gènes, etc.
Protection des habitats
Le maintien des habitats est généralement nécessaire à la conservation des espèces, et ils représentent eux-mêmes une facette de la biodiversité qui mérite d’être protégée. Cela peut être mis en œuvre grâce à des aires protégées, un principe qui regroupe une grande variété de réglementations, et de moyens de surveillance.
Des opérations de restauration d’écosystèmes dégradés peuvent être mises en place, notamment grâce à la culture, la plantation, la lutte contre les espèces envahissantes, voire des techniques d’ingénierie très sophistiquées. Il est compliqué de déterminer quel par rapport à quel point de référence on veut restaurer, selon des critères historiques, évolutif, de santé, etc. Du laisser-faire aux biotechnologie, la conservation regroupe des projets et des moyens très différents.
Entre nature et artifice
Bref, la conservation de la biodiversité ne va pas de soi, elle fait l’objet de nombreux débats techniques. Par dessus-tout, la question porte sur les valeurs et les finalités, notamment sur la distinction en naturel et artificiel. Il n’y a pas le naturel d’un côté et l’artificiel de l’autre, mais un continuum entre les deux. La conservation est un éventail d’options avec différents degrés de naturalité ou d’artificialité. Cependant, en décrédibilisant ou délaissant l’idée de nature sauvage et sa défense, on réduit l’éventail de ces options jusqu’à le faire disparaître. La conservation devrait donc garder à cœur la protection de territoires dans lesquels les processus naturels peuvent se maintenir et évoluer indépendamment des bénéfices que les humains peuvent en tirer – mais pour cela, il nous faut un concept de nature sauvage.
Et par ailleurs, la continuité évolutive et historique des milieux naturels est une valeur fondamentale de la nature qui mérite notre attention et notre respect, aux antipodes de la vitesse et de la frénésie. La préservation la nature et son temps long n’est pas un problème à mettre entre les mains des ingénieurs. Elle nécessite donc une résistance à la technologie, la surexploitation des ressources, la fragmentation des habitats naturels et aux énergies fossiles.
Absorption économique
On va à présent examiner l’absorption de la nature par la marchandise. Puisque le développement économique représente la principale menace pour la nature, certains tentent de la préserver en la valorisant en terme de croissance et de profit. La protection de la biodiversité serait ainsi, nous dit-on, une opportunité économique. On va voir plusieurs expressions et concepts accompagnant cette perspective : le “capital naturel”, les “services écosystémiques”, la “comptabilité verte” et la “compensation écologique”.
Capital naturel
Le capital naturel sert a désigner les éléments et processus naturels jugés bénéfiques pour l’enrichissement de certains humains, par le maintien et l’accumulation de capital. Cette métaphore traduit deux visions :
- Vision mécaniste : réduction de la nature et des êtres vivants à des machines. Une rivière devient une usine à poissons.
- Vision économiciste : la nature génère des biens et des services. Une rivière est une usine à profits.
Services écosystémiques
Les “services écosystémiques” désignent uniquement certains éléments de la nature dont les humains peuvent tirer avantage. Non seulement il s’agit d’une vision qui réduit la nature en la centrant sur les humains, mais c’est une notion qui n’est pas la même selon les groupes humains et les circonstances. Les “services écosystémiques” risquent d’être entendus du point de vue des groupes dominants, en fonction de leur bien-être et de leurs bénéfices économiques. Par ailleurs la mise en marché des services écosystémiques posent tout un tas de problèmes, notamment liés à la complexité des systèmes vivants. Les interactions sont trop nombreuses et enchevêtrées pour les individualiser.
La comptabilité verte
La “comptabilité verte” nécessite de réduire la nature à des dimensions instrumentales, quantifiables et commensurables. Elle renvoie à un horizon apolitique dans lequel experts et bureaucrates sont en charge des prises de décisions.
La compensation écologique
L’absorption économique passe aussi par une prétendue “compensation écologique” ou un objectif “pas de perte nette”, ou encore la “règle verte”. La nature est ainsi considérée comme un capital dont il conviendrait de maintenir la valeur absolue : sa composition peut varier à condition que les dépenses n’excèdent pas les bénéfices. La compensation sous-entend que les milieux naturels sont substituables alors que l’enjeu même de la préservation est leur caractère irremplaçable.
Dans les faits, ce dispositif permet d’ouvrir une nouvelle niche financière, permettant aux développeurs de facilement verdir leur image publique, et aux ONG de trouver des financements. En outre, la logique de pollueurs-payeurs rend la conservation dépendante de financements privés de la part de ceux-là même qui détruisent la nature. La conservation de la nature dépend ainsi de sa destruction – félicitations.
Une vision réductrice des valeurs
Ces notions sont donc une réduction anthropocentrée, instrumentale et économique de la nature. Or, les valeurs qui nous lient au monde naturel sont plus grandes que ça, elles ne sont ni quantifiables, ni substituables Les métaphores économistes ne peuvent pas rendre compte des valeurs culturelles et non anthropocentrées, morales, esthétiques, scientifiques que nous attachons à la nature sauvage et qui sont nos meilleures raisons de la protéger.
Défendre la nature sur le terrain du profit, c’est se contraindre à jouer dans le camp adverse et se priver de nos arguments les plus convaincants. La nature n’est pas un capital. Elle n’est pas figée et nous n’en disposons pas. Le désastre environnemental est très largement le fruit d’une société de croissance, de consommation, d’accumulation et d’individualisme. Nous ne pourrons pas régler le problème en empruntant la vision du monde qui en est à l’origine.
Absorption bureaucratique
Il s’agit d’une troisième dissolution de la nature, plus indirecte et symbolique, qui passe par les dispositifs de suivi et l’accumulation des données. La “mise en donnée” du monde naturel efface le souci pour les phénomènes eux-mêmes au profit d’une attention aux données qu’ils génèrent. Elle participe d’un processus plus large d’abstraction, et invisibilise le caractère dramatique du désastre écologique.
Accumulation des données
Depuis une vingtaine d’année, on passe d’une collecte “artisanale” d’informations sur les sites, et très peu de partage à leur sujet, à une massification constante des informations, de leur stockage et de leur mise en commun. Cette évolution est encouragée par les innovations technologiques, la participation de citoyens amateurs aux inventaires, la numérisation des données, les outils de communication, etc.
Rupture dans les savoirs
Cette explosion de données n’est pas nouvelle dans l’histoire, comme en témoignent déjà les naturalistes de la Renaissance, dépassés par la masse d’informations à laquelle ils font face, relativement aux moyens de l’époque. On observe aujourd’hui un changement de degré de la massification des données, mais surtout, on assiste à deux ruptures significatives dans les sciences de la biodiversité :
- la prévalence des outils statistiques sur l’interprétation, ce qui nécessite de collecter le plus de données possibles ;
- la fragmentation des acteurs impliqués dans le processus.
Conséquence sur les objets d’étude
La centralisation et standardisation des données aux formes et aux finalités très variées implique inévitablement une perte d’informations. Certains objets difficiles à classifier, généraliser ou délimiter, tendent à échapper aux bases de données et sont invisibilisés. L’incertitude et la singularité, caractéristiques de l’étude de la nature, en sont irrémédiablement exclues.
Virtualisation de la crise
La mise en données de la biodiversité globale n’est pas une entreprise anodine. Elle tend à virtualiser le problème de la disparition de la nature ; et elle contribue à cette disparition en imposant une transparence totale du monde naturel. On virtualise la crise environnementale au moment même où, plus que jamais, il est urgent d’en percevoir la réalité matérielle et d’en éprouver le sens. La nature, assimilée à la sphère des systèmes d’informations, est niée dans son autonomie.
Par ailleurs, dans cette “course aux données”, jusqu’où nous sentons-nous autorisé·es à intervenir dans la nature pour lui “arracher ses secrets” grâce à une quantité astronomique d’appareils technologiques de surveillance ? Un tel acharnement perturbe les milieux naturels et dérange les animaux. Si l’enjeu est de protéger la nature, les moyens sont-ils adaptés aux fins ? Faut-il suréquiper le monde sauvage pour assouvir le désir de le dévoiler totalement ? Respecter le sauvage implique aussi d’accepter qu’il nous échappe. Le désir de tout voir, de tout savoir, est une autre version du délire tyrannique de contrôle total.
Les limites de la “réconciliation”
Une réconciliation sans limite ?
Dans son livre L’Écologie gagnante-gagnante, Rosenzweig déclare que la seule façon d’éviter l’extinction d’un grand nombre d’espèce est de se réconcilier avec la nature, en organisant l’espace de façon à le partager avec d’autres formes de vie. Cette approche est tout-à-fait valable si on examine les milieux déjà fortement anthropisés, comme les villes et les champs. En revanche elle pose problème lorsqu’il est question des espaces qui ne sont pas encore exploités : elle ne remet pas en cause l’extension de l’empire humain. Il s’agit de transformer les tyrans mortifères en souverains bienveillants, mais le temps n’est-il pas venu d’envisager les limites de notre emprise ?
Avec quoi comparer ?
Au-delà des interactions mutuellement bénéfices pour les sociétés humaines et les autres espèces, le maintien et l’extension d’une vie non humaine authentiquement sauvage demeure un enjeu fondamental. Pour savoir si une interaction est bonne ou mauvaise pour les autres espèces, encore faut-il pouvoir comparer la nature en contexte d’influence humaine avec celui de libre évolution.
Du fait d’une dégradation progressive, nous nous habituons à une situation qui aurait semblé inacceptable si elle était survenue brusquement. Ce phénomène de “référence glissante” touche aussi la conservation, dont les objectifs découlent d’une situation déjà très appauvrie qui ne devrait pas nous servir de cadre de référence. Voilà aussi pourquoi il est nécessaire de conserver une référence à la nature sauvage, autonome, dans laquelle les influences humaines sont légères et réversibles. Cette conservation, loin d’être une entrave à la réconciliation, permet de mieux envisager la cohabitation là où elle a lieu.
Une gradation de relations
Par ailleurs, ce n’est pas dans le livre de Virignie Maris, mais on peut rappeler que la nature n’est pas seulement constituée de relations bienveillantes, ou réconciliées – peu importe ce qu’on entend par là. Dans Les êtres vivants ne sont pas des machines, Bertrand Louart mentionne toute une gradation de relations possibles entre les espèces, de la plus coopérative à la plus antagoniste, participant ainsi à la richesse de la vie et de la nature :
- le mutualisme : mutuellement profitable ;
- la symbiose : mutuellement bénéfique, mais obligatoire pour au moins l’une des deux espèces ;
- le commensalisme : une seule des deux espèces en tire profit ;
- le parasitisme : au détriment de l’hôte ;
- la prédation : au profit du prédateur, au détriment de la proie ;
- la compétition : concurrence pour l’appropriation de ressources vitales.
Pas de réconciliation avec la civilisation industrielle
La civilisation industrielle se maintient en accaparant une part énorme des ressources planétaires, provoquant une extinction de masse d’origine humaine. Chaque jour se multiplient les projets de destruction de ce qui reste de milieux naturels : aéroports, entrepôts, centrales éoliennes et solaires, étalement urbain, densification des transports, etc. Plutôt qu’une simple réconciliation, ce sont de profondes remises en question, bouleversements et résistances qui sont nécessaires si nous cherchons réellement à cohabiter positivement avec le monde sauvage.

4. Défendre la part sauvage du monde
Comprendre le dualisme
Les réflexions précédentes sur le grand partage nous ont laissé dans une sorte de contradiction :
- d’une part il est évident que le dualisme de la modernité n’est pas une voie satisfaisante pour penser notre rapport à la nature ;
- d’autre part la grande absorption n’est pas la réponse appropriée.
Cependant, Virginie Maris souhaite réinvestir le concept de nature-altérité de façon dialectique (analyser les contradictions) plutôt que dualiste (deux sphères absolument étanches et hiérarchisées). L’enjeu est de réaffirmer la distinction entre la nature et les affaires humaines tout en refusant le dualisme – c’est-à-dire la hiérarchie. Si on veut échapper au dualisme, il nous faut tout d’abord le comprendre.
Val Plumwood, philosophe et écoféministe australienne, a montré comment le dualisme n’est pas une simple dichotomie, mais une transformation des catégories dichotomiques en outils d’oppression et d’aliénation (culture/nature, esprit/matière, masculin/féminin, etc.) Parce que leur compréhension essentielle, et que je ne vois pas comment mieux les résumer, je reprends ici telle quelle la description des 5 mécanismes du dualisme que fait Virginie Maris (déni, exclusion radicale, incorporation, homogénéisation, instrumentalisation). Ils sont limités au contexte de la protection de la nature-altérité, mais peuvent être utilisés pour penser d’autres dualismes.
1. Le déni
Le déni consiste à minorer, ignorer, voire nier l’existence de l’autre ou certaines caractéristiques qui lui sont essentielles. Ce faisant, on oblitère les interdépendances et la réciprocité. C’est le processus typiquement à l’œuvre dans les discours de l’Anthropocène qui nient l’existence d’une nature indépendante des humains et toute notre réflexion jusqu’ici s’est attachée à dénoncer un tel déni.
2. L’exclusion radicale
Il s’agit de nier toute ressemblance, tout continuum possible entre les parties distinguées, pour s’assurer que le membre dominant n’ait absolument rien en commun avec le membre dominé. Une certaine conception des réserves intégrales comme zones d’exclusion de toute activité humaine, quitte à devoir pour cela expulser des populations installées de longue date et vivant en bonne intelligence avec les autres espèces, est un exemple caractéristique de ce processus d’hyperexclusion. La négation de la part de sauvage qui subsiste y compris dans des milieux fortement anthropisés relèverait du même procédé. Nous verrons que l’on peut penser l’extériorité dans un registre qui ne cède pas à ce régime de stricte séparation.
3. L’incorporation
Le membre dominé est défini seulement relativement au membre dominant (la femme de…, l’esclave de…). On ne considère pas ses caractéristiques propres mais uniquement ce qui le distingue, et le plus souvent ce qui lui manque, par rapport à l’autre membre de la dichotomie. C’est ce qui se passe quand on définit la nature comme l’absence de culture et c’est un écueil auquel nous n’avons pas complètement échappé jusque-là. Il nous faudra donc investir la notion d’altérité, pour remplir la nature de ce qu’elle est et ne pas seulement la définir par défaut de ce que nous sommes.
4. L’homogénéisation
C’est le procédé qui efface la diversité au sein du terme dominé (les réfugiés, les étrangers, les femmes, comme si, à l’intérieur de ces catégories, tous étaient semblables). Ici encore, c’est un écueil qui plane sur le concept même de “nature” quand on l’utilise au singulier et c’est pourquoi nous avons souvent pris le soin de faire également référence aux entités naturelles, aux animaux non humains, aux êtres de nature. Un examen plus attentif de l’altérité de la nature nous permettra de préciser qu’elle est en fait le siège d’une multitude d’altérités.
5. L’instrumentalisation
C’est ce qui est le plus évidemment à l’œuvre dans la conception moderne de la nature comme simple moyen disponible pour des finalités humaines. Cette objectivation du monde non humain a été abondamment discutée et critiquée, […] nous verrons comment la reconnaissance de l’autonomie de la nature peut servir de rempart à cette objectivation.
Les attributs de la nature
En mettant en évidence ces mécanismes, Val Plumwood montre en fait que « nous n’avons pas à abandonner les dichotomies, ni les différences, pour éviter le dualisme ». Afin de penser la différence de la nature, de la part sauvage du monde, de façon non hiérarchique, nous allons examiner ses trois attributs : l’extériorité, l’altérité et l’autonomie.
Extériorité
L’absorption bureaucratique la nature, est une façon de lui nier toute extériorité aux affaires humaines par l’hypersurveillance et virtualisation. Plus rien ne serait extérieur. C’est contre ce déni que nous affirmons l’extériorité de la nature, ce qui nécessite de se donner des limites. Il convient pour cela de repenser la frontière entre nature et culture, non comme une dichotomie mais comme une dialectique (échange, dialogue, réflexivité). Ainsi, le sauvage n’est pas une toile de fond inerte, mais l’autre face de notre humanité, avec laquelle nous partageons une longue histoire.
Les frontières sont aujourd’hui l’outil du repli sur soi, de l’exclusion, du privilège. Mais la frontière n’est pas le mur, elle peut être une zone d’échange, de dialogue, où l’on se rencontre sans se perdre. Elle permet de reconnaître sa propre identité et l’altérité d’autrui. Les frontières naturelles engendrent la diversité du vivant, elles sont gardiennes de la multiplicité. Les frontières culturelles, lorsqu’elles ne sont pas des parois étanches qui étouffent les populations, produisent et maintiennent une diversité de langues, de traditions, d’organisations sociales.
Contre un monde plat, sans limites, piloté par gouvernance mondiale, la part sauvage du monde instaure des plis, des enclaves, des refuges et du relief. Repenser la distinction entre le monde humain et le monde sauvage, ce n’est pas en faire un mur infranchissable, mais un lieu d’échange et de différenciation, garantissant la souveraineté du monde sauvage et le protégeant de l’exploitation et de l’aliénation.
Altérité
Après avoir entendu l’existence d’un monde hors de nous, extérieur à nous (extériorité), on peut se demander de quoi est fait ce monde que nous n’avons pas créé (son altérité). L’absorption technique de la nature, en brouillant les frontières entre nature et artifice, nous rend aveugles à l’altérité véritable qui caractérise le monde sauvage. Contre le dualisme qui homogénéise tout ce qui est autre, il nous faut penser les altérités du monde sauvage. La nature se compose d’une multitude d’êtres, de mondes fragmentés et de perspectives diverses et singulières.
Parler de la nature n’implique pas nécessairement d’en faire une substance indifférenciée, elle devrait plutôt désigner un enchevêtrement de vies, de relations, de perspectives.
Autonomie
Reconnaître une nature extérieure et la multiplicité des mondes n’est pas suffisant. Au nom de quoi devrions nous respecter cette extériorité et ces altérités ? L’absorption économique de la nature, l’instrumentalisation du monde, est la tendance à nier les finalités propres de ces entités extérieures et multiples afin de les asservir à nos propres fins.
La nature n’est pas à distinguer sur le mode de la carence, elle est autre, mais elle n’est pas moins. Elle est un royaume distinct de celui des humains, peuplé de sens et de finalités qui nous échappent.
Comment cette perspective peut se traduire politiquement ? Par exemple par le respect de l’autonomie des communautés sauvages, de leur capacité à vivre, à relever leurs propres défis et à façonner leur communauté sans intervention extérieure. Penser politiquement notre relation aux animaux sauvages, c’est la considérer non plus seulement comme un lien à des individus particuliers, mais vis-à-vis de communautés ayant leur propre fonctionnement et réalisant des finalités qui nous échappent.
La résilience, la diversité, la capacité à conserver leur identité à travers les changements sont autant de marqueurs du caractère auto-organisé de ces communautés. Au-delà de l’autonomie individuelle des animaux sauvages, c’est aux communautés biotiques interspécifiques complexes toute entières que l’on devrait attribuer la souveraineté.
Ce que le respect du sauvage n’est pas
Réponse à trois accusations courantes à l’encontre des discours et politiques préservationnistes, supposément fixistes, misanthropes, néocoloniaux.
La conservation, c’est fixiste.
En mettant la nature sous cloche, vous adoptez une vision fixiste du vivant. Vous tentez de maintenir les milieux dans un état de stabilité permanente et immuable, est-ce que vous êtes contre l’évolution naturelle ?
Pas du tout, les pionniers de la conservation la décrivait déjà dans un cadre résolument évolutif, dans lequel la biodiversité est tout à la fois le produit de l’évolution passée et le potentiel de l’évolution à venir.
Pourtant vous accordez de l’importance aux espèces en voie de disparition, et particulièrement aux grosses bêtes. Vous savez que l’évolution est faite d’extinctions ? Les grosses bêtes sont simplement mal adaptées.
Certes, certains animaux attirent plus que d’autres les faveurs du public. Cela pose problème, mais difficile de faire autrement puisque la protection de la nature est un enjeu social. En revanche, protéger des espèces menacées par les activités humaines n’est pas contradictoire avec la pensée évolutionniste, au contraire. Le déclin actuel de la biodiversité se produit à une vitesse sans commune mesure avec les extinctions naturelles. L’intensité et la rapidité de ces changements laissent très peu de chances de s’adapter aux espèces, tout particulièrement les grosses bêtes.
En outre, ces espèces emblématiques ont souvent des rôles fonctionnels structurants. Les protéger, c’est préserver des paysages et des écosystèmes entiers. Et puisque les espèces sont en interaction, on ne peut pas garantir la survie d’une population sans le maintien de son habitat, proies, ressources, etc. Leur protection contribue donc au potentiel d’adaptation des communautés écologiques auxquelles elles appartiennent.
De toutes façons, vos aires protégées sont inutiles face au réchauffement climatique, les animaux et les plantes n’auront pas la possibilité d’y évoluer.
La fragmentation des milieux limite en effet les capacité d’adaptation, mais cela ne justifie certainement pas de les délaisser, au contraire. Nous devons militer pour des espaces naturels plus grands et une meilleure connectivité entre eux pour permettre aux populations de se déplacer.
La conservation, c’est misanthrope
Si vous voulez protéger la nature sauvage, c’est sûrement parce que vous détestez les humains.
Non, la valorisation du sauvage n’implique pas la dévalorisation de l’humain. Aimer la musique n’implique pas de détester la littérature. Ce n’est pas parce que les humains sont mauvais que nous voulons protéger la nature sauvage, mais tout simplement parce qu’elle est en train de disparaître, et avec elle la diversité du monde, ses potentialités, ses surprises. Une étude récente prévoit qu’au rythme actuel de destruction il ne restera plus dans un siècle un seul espace de nature sauvage.
Alors pourquoi de nombreux défenseurs de la nature ont-ils vanté les mérites de la solitude ?
Parce que prendre de la distance et du recul hors de la société peut permettre de l’observer et de la critiquer radicalement. Et c’est le plus souvent par soucis des humains que les critiques de l’industrialisation et du consumérisme ont décrié que cette culture dévorait tout autant la planète que les ouvriers, les femmes, les esclaves.
Vous favorisez des politiques néomalthusiennes, un contrôle démographique incompatible avec le respect des libertés fondamentales, c’est inadmissible !
En effet, le mouvement environnementaliste américain des années 70 était obnubilé par la question démographique. Bien sûr, le nœud du problème n’est pas tant le nombre d’humains que leur façon de vivre et de consommer. Les activités les plus destructrices de nature sauvage ne servent pas à construire des abris ou à donner accès à des terres pour une agriculture de subsistance. Ce sont des projets de plantation de palmiers à huile, d’extraction de minerais, d’exploitation de nouvelles sources d’énergie fossile, etc. – la civilisation industrielle.
La question démographique est passée, pour de bonnes raisons, à l’arrière-plan des discours environnementalistes. Cependant, les discours autoritaire, eugénistes ou xénophobes ne sont pas les seules façons de discuter de la taille de la population humaine. La projection d’une société future émancipée ne peut pas esquiver la question des limites matérielles. Pour approfondir les débats entre Malthus et les libertaires, il y a tout un chapitre à ce sujet dans La liberté dans un monde fragile, de José Ardillo. Par ailleurs, le contrôle des naissances est aussi un enjeu féministe. L’idéologie de la croissance se manifeste en partie par les injonctions de reproduction faites aux femmes ; et l’asservissement de leur ventre au projet de toute-puissance des hommes.
La conservation, c’est neocolonial
La conservation vient d’une vision particulière de la nature sauvage, issue de la société et de l’histoire américaine. Dans les faits, elle conduit à des politiques néo-coloniales impérialistes, qui dépossèdent les communautés locales de leurs terres pour créer des parc nationaux.
Ici encore on voit qu’on ne peut pas traiter nature et liberté de façons indépendantes. En effet, dans le cadre d’une société colonialiste et patriarcale, il y a rien d’étonnant à ce que la conservation en présente les attributs. C’est aussi vrai pour la santé, l’éducation, la justice. Les torts irréversibles que certaines politiques de préservation ont fait subir aux populations locales ne doivent pas être répétés.
Il faut toutefois admettre que la cause n’en était pas tant le respect de la nature sauvage que le non-respect flagrant des peuples et de leur autonomie. La préservation peut tout aussi bien servir de rempart pour protéger des cultures et des modes de vie menacés par les multiples projets de destruction et d’exploitation de la civilisation industrielle.
Conclusion
Chercher la nature sauvage dans le temps
En remontant le temps, on peut se faire une idée de ce dont la nature est capable quand elle n’est pas aliénée à nos désirs, en terme de diversité et d’abondance. On estime par exemple que la part des humains dans la biomasse totale des mammifères était de 3 % il y a 10 000 ans, contre 36 % aujourd’hui, auxquels s’ajoute 60 % d’animaux domestiques, ne laissant qu’un petit 4 % pour les animaux sauvages. De telles perspectives historiques représentent un antidote au syndrome de la référence glissante.
Chercher la nature sauvage dans l’espace
Malgré les destructions et les pollutions, il reste encore sur Terre des territoires suffisamment peu influencées pour être qualifiés de sauvages, des zones de wilderness. Les études concernant ces espaces révèlent l’importance cruciale qu’il y a de les protéger pour préserver la diversité et le potentiel d’évolution du monde vivant.
Dire qu’il n’y a plus de nature est une façon bien facile de ses débarrasser de toute responsabilité à l’égard de ces régions encore largement sauvages et menacées.
Mots de fin
Pour terminer, l’autrice rappelle l’arnaque que constitue la “transition énergétique”. Réduire la crise environnementale au simple problème climatique et au solutionnisme technologique se fait bien évidemment au détriment de la nature sauvage. Les “solutions” technologiques prônées pour lutter contre le réchauffement climatique – puisqu’elles ne s’opposent pas à la civilisation industrielle, – nécessitent d’empirer la destruction de la nature.
En outre, l’absence de contact avec la nature dans une population de plus en plus urbaine réduit les chances de résistance. Comment pourrait-on se mobiliser pour défendre une nature avec laquelle on a aucune relation ? Inventer des façons plus douces de cohabiter avec le vivant non humain est donc un enjeu essentiel. Cependant, sans référence à une nature non contrainte par les influences humaines, il est impossible de se donner une idée du niveau de diversité et de densité que les milieux naturels peuvent contenir. Aujourd’hui, les aires protégées sont des refuges, mais si nous atteignons notre objectif, elles deviendront les sources du réensauvagement du monde.
Notre meilleur espoir est de tenter de prendre le point de vue de la nature, celui d’une nature libre, autonome, foisonnante. Une nature qui nous rendra probablement peu service, dans laquelle nous nous sentirons peut-être vulnérables et malvenus. Mais faudrait-il que l’on soit partout chez soi ? Par ailleurs, respecter le sauvage, tel que nous l’avons envisagé, ce n’est pas s’abstenir de toute relation. Marcher, observer, accompagner, étudier, pister ou imiter sont autant de façons d’interagir passivement avec la nature, dans des liens discrets mais immensément satisfaisants et uniques.
Critiques
J’ai cependant une critique à faire à cet ouvrage, c’est son manque d’appel à confronter directement la civilisation industrielle en son cœur. Certes, le sujet du livre est plus une discussion sur le partage nature/culture et les attributs de la nature sauvage plutôt que des questions d’ordre stratégique. Mais en lisant les dernières pages, je suis frappé par la mollesse des perspectives de lutte au regard des idées puissantes qui sont soulevées pendant tout le livre. Comme mot de conclusion, Virginie Maris, sur les traces de Morizot, nous invite à “lâcher prise”, à “s’affranchir du désir de contrôle”, à faire preuve d’“humilité”. Tout cela est intéressant, mais ne constitue pas une résistance politique. Être humble et lâcher prise n’est pas à la hauteur du problème. Un mouvement doit s’organiser pour viser les infrastructures qui détruisent la planète, et démanteler le système politico-économique qui en est responsable. C’est notre seule chance de sauver la nature sauvage.
Toutefois, sur la question philosophique et politique de la différence sans la hiérarchie, sur la déclaration d’amour pour la nature-alterité, pour ses mystères et sa beauté, ce livre de Virignie Maris constitue une très belle référence. J’espère vous avoir donné envie de vous y plonger par vous-mêmes.
Écriture et musique : Lorenzo Papace
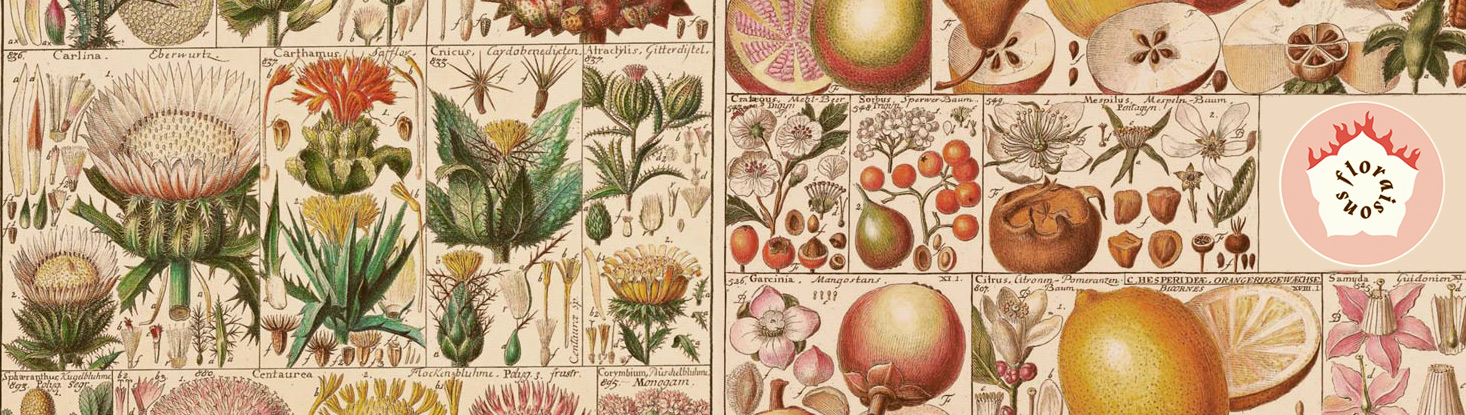


Elisée Reclus
Posted at 11:32h, 16 maiLe troisème épisode porte le nom du deuxième, le fichier est bon.
stagiaire floraisons
Posted at 13:40h, 04 juinMerci bien, c’est corrigé.
Ace
Posted at 18:36h, 05 févrierMerci pour cette série et la restitution du contenu du livre – très précieux.
Le ton universiteux / le côté jargonneux avaient pas mal obscurci le fond du message pour moi… D’en écouter/lire votre version raccourcie et traduite en français normal, ça m’a réconciliée avec Virginie !
stagiaire floraisons
Posted at 10:06h, 07 févrierMerci beaucoup, en espérant que la restitution est assez fidèle aux écrits de l’autrice.