
Divertir pour dominer (deuxième partie) 04 Avr 2020

TÉLÉCHARGER LE PODCAST
Vous êtes accro aux jeux vidéos ? Vous êtes habitué·es des sites de rencontre ? Le porno a participé à l’apprentissage de votre sexualité ? Vous êtes victimes d’achats compulsifs ? Voici quelques-uns des visages du capitalisme contemporain et de la culture de masse que ce podcast propose d’observer.
Il faut des stimulants de plus en plus puissants aux gens qui vivent dans une société anesthésiée pour avoir l’impression qu’ils sont vivants.
Cet épisode est réalisé à partir de l’ouvrage Divertir pour dominer 2, dirigé par Cédric Biagini et Patrick Marcolini. aux Éditions l’Échappée, des lectures choisies et présentées par Audrey. Il fait suite à la première partie qui portait sur l’industrie des séries vidéos.
Le jeu
Dans le discours dominant et les innovations technologiques qui l’accompagnent, le réel doit être augmenté, simplifié, médiatisé, bref, la vie devient un jeu, ce qui veut dire qu’elle s’accompagne de règles — écrites par l’industrie. L’idéologie capitaliste exploite les ressorts psychologiques des individus, tels que l’appât du gain de la récompense. Le monde est réduit à un rapport marchand fondé sur la jouissance et sur les sensations.
Guerre
Le jeu est devenu un acteur fondamental du libéralisme. Grâce à l’industrie vidéoludique, ce dernier s’impose dans sa version la plus technophile : la guerre, un jeu comme les autres. Les relations entre domaine militaire et jeu sont anciennes, elles sont aujourd’hui inextricables. Les jeux ne servent plus simplement d’entraînement stratégique et mécanique, ils deviennent de véritables interfaces de machines de guerre bien réelles. C’est par exemple le cas avec l’utilisation des drones qui permettent aux soldats de détruire à distance, grâce à des commandes proches voire identiques à celles des jeux. La gamification de la guerre accompagne l’abstraction technologique de l’assassinat.
Travail
Plaisir et jouissance de petites récompenses à court terme anesthésient les consciences et infantilisent les individus. Le jeu au service du capitalisme permet d’amollir la masse, de la contrôler par le moyen de faibles réjouissances, de divertissement, de fun. Le travail lui-même devient ludique, comme c’est le cas des serious game. La productivité des travailleur·e·s est mesurée et contrôlée, tout en les gratifiant de récompenses virtuelles s’ils et elles atteignent des scores. Grâce à la gamification de l’exploitation, l’esclavagisme contemporain peut faire des économies sur l’usage de la violence physique.
Méritocratie
Le 20e siècle a connu des modifications sociales structurelles, une amélioration des conditions de vie, et une relative « ascension sociale ». Par exemple dans les années 60 et 70, des enfants d’ouvrier·ère·s pouvaient espérer devenir cadre moyen ou supérieur. Ce processus et l’imaginaire méritocratique qui l’accompagne sont aujourd’hui remis en cause. Or, dans le virtuel et les jeux, ils sont toujours à l’œuvre, le niveau monte avec l’expérience, ce qui est réconfortant dans un monde qui l’est de moins en moins.
Cultures extrêmes
Pornification, le stade pornographique du capitalisme
Le porno est-il une culture ? Qu’est-ce qu’une culture ? Depuis un moment déjà, le sens humaniste du mot culture (fréquentation des classiques, approfondissement des connaissances, exercice de la réflexion comme facteur d’accomplissement) est concurrencé par la nouvelle définition donnée par les sciences sociales (une manière de vivre et de penser cristallisée aussi bien dans les œuvres que dans les objets usuels, les gestes et comportements). Ce qui permet au porno, pour gagner en légitimité, de se présenter non pas comme une industrie mais comme une culture à part entière.
Quand certains journaux et intellectuel·le·s parlent de porn culture, ils adoptent donc le vocabulaire des industriels du secteur et se soumettent à leurs stratégies commerciales. Pour eux, la pornification généralisée serait un phénomène naturel. La porn culture ne serait qu’une facette en plus de la pop culture. Mais cette vague du porno ne relève pas simplement du divertissement et n’est pas qu’une reconfiguration de la culture de masse. Replacée dans le contexte plus global des mutations du capitalisme patriarcal et de l’industrie, elle apparaît plutôt comme une forme particulièrement exacerbée d’impérialisme de l’économie et de la technologie sur nos esprits comme sur nos corps.
Le porno étant la pointe la plus avancée du capitalisme contemporain, il n’est guère étonnant d’y retrouver l’exploitation la plus sauvage. Les actrices et acteurs sont ubérisé·es, de moins en moins bien payé·es, à la tâche, comme dans l’industrie du 19e siècle. Les revenus en ligne des camgirls varient en fonction des bonnes ou mauvaises notes reçues, puis les plateformes prélèvent en moyenne 70 %. Les actrices sont cotées sur un marché en ligne comme des matières premières, périmées après quelques mois du fait de la demande en nouveauté constante, quand il ne s’agit pas des dégâts subis par leur corps. Les productions sont délocalisées en Europe de l’Est et en Amérique du Sud pour bénéficier d’une main d’œuvre moins chère et d’une législation laxiste.
Un nouveau style de porno est apparu dans les années 90-2000, le gonzo. Afin de réduire drastiquement les coûts et faire le maximum de profit, l’industrie pornographique s’est débarrassée du scénario, des décors, des dialogues et de tout éclairage élaboré, et même du réalisateur, lui-même devenu acteur. Pour se démarquer des autres productions, le gonzo a fait le choix de banaliser la violence, les actrices étant giflées, frappées, humiliées, étouffées jusqu’au vomissement ou l’évanouissement, pénétrées de force avec toutes sortes d’objets selon des pratiques qui confinent au viol. Cette pornographie de la démolition est aujourd’hui devenue la norme et représente 95 % des productions.
Les actrices et acteurs souffrent de violences psychologiques et d’épuisement physique (hématomes, irritations, saignements, détérioration des organes sexuels), parfois jusqu’au suicide ou à l’overdose. Si les actrices et les acteurs veulent continuer à travailler, elles et ils sont obligé·e·s de minorer les souffrances liées à leur activité et de ménager leurs employeurs. Comme les femmes prostituées et les mères porteuses, les actrices peuvent aussi s’engager dans un processus de dissociation de soi, se déconnectant de la situation vécues et de leur corps. Il s’agit d’une variante particulièrement exacerbée et appliquée aux questions sexuelles de la réification qui touche tous les individus en régime capitaliste.
Catalogues, profusion d’images, liberté de choix, économie de marché, publicité, spectacle : le porno est la marchandise par excellence. Mais la satisfaction du consommateur sera toujours à distance, incomplète, et la frustration qui en résulte relance à son tour le désir, qui devient peu à peu besoin aliéné. Le porno, comme le capitalisme, ne voit dans l’être humain qu’une source de profit, manipule ses désirs pour lui imposer des besoins. La marchandise pornographique pornifie tout ce qu’elle touche, ce qui se transforme à son tour en marchandise.
il est le capitalisme.
Les atteintes physiques et psychologiques infligées aux actrices sont documentées, de l’exploitation économique la plus brutale jusqu’aux viols. Mais pour Judith Butler, ce problème ne mérite pas qu’on mette en cause l’industrie du porno en elle-même. Selon elle « la solution passe par une amélioration des salaires, des contrats et une protection sociale des actrices », la syndicalisation de ces femmes, la reconnaissance du statut de travailleuses du sexe. Or, ce concept implique de facto une position relativiste quant au degré d’exploitation qu’une femme peut subir. « Qu’il s’agisse d’une secrétaire, d’une femme de ménage ou d’une prostituée, chacune expose son corps en première ligne ». Ainsi actrice ou acteur X serait un job comme un autre, en conformité avec la logique abstraite du capitalisme qui n’évalue que la quantité de temps dépensé pendant un travail.
Transgressions individualistes
L’objectif de certaines œuvres contemporaines semble être de forcer à suspendre complètement tout jugement moral. On se demande si en fait de se dépouiller d’une certaine morale assimilée à un outil d’oppression, il ne s’agirait pas plutôt de se dépouiller de la morale, de n’importe quel cadre moral. La conception contre-culturelle de la rébellion consiste moins à transformer les règles et repères qu’à les abolir complètement, car ces repères seraient par essence répressifs et liberticides.
Le franchissement de limites morales a souvent été considéré par la gauche progressiste comme porteur d’une charge de rébellion, voire comme révolutionnaire. Cette conception de la transgression est très répandue, elle consiste à dénoncer l’ordre moral bourgeois ; et elle continue à prévaloir aujourd’hui alors que le contexte et les rapports de force n’ont plus rien à voir. Elle se perpétue encore au sein de la gauche, qui tout en dénonçant le libéralisme économique, adhère en fait à l’imaginaire libéral sur le plan politique et culturel. Non seulement il ne s’agit pas de dénoncer le système néo-libéral, mais le perpétuel franchissement des limites applique seulement aux œuvres ce qui est la dynamique même du système culturel et économique qui domine le monde, le capitalisme néo-libéral.
L’égoïsme le plus total est célébré au nom de l’émancipation. Pourtant l’individualisme absolu conduit à la destruction de l’individu. Lorsque l’assouvissement du désir illimité fait loi, le fort peut disposer du faible pour son plaisir, ce qui inclut le viol, la torture, le meurtre. Une conception solipsiste de l’individualité où la glorification de soi finit par avoir pour revers la destruction d’autrui. Cet enthousiasme intellectuel de la contre-culture pour la transgression ou la subversion — subversion que le système semble très bien tolérer — vient de l’abandon du champ de la lutte politique au profit du champ culturel. Le passage de l’action collective concertée à l’adoption d’attitudes individualistes, au fond antisociales.
Le rejet absolu de toute morale, de toute limite, nous condamne surtout à ne plus avoir de repères, de normes, donc de moyens de penser le monde, de se situer, se reconnaître et s’assigner des limites individuelles et collectives — ce qui entre autres choses distingue les psychopathes et sociopathes de l’être sociable. Réhabiliter une critique réellement critique qui ne craindrait pas d’être dénoncée comme conservatrice ou réactionnaire est un enjeu démocratique, le moteur même de la démocratie résidant dans la confrontation et la mise en tension d’opinions, de jugements, d’idéologies, d’éthiques.
Le consumérisme comme culture
« Dis moi ce que tu consommes et je te dirai qui tu es ».
Selon le sociologue Zygmunt Bauman, nous serions passés d’une société de producteurs à une société de consommateurs. Bien évidemment le travail est loin d’avoir disparu et les individus peuvent dans leur grande majorité être considérés comme des producteurs. Mais ce n’est plus qu’à titre secondaire que la société les engage en tant que tels. C’est l’activité de consommation et non de production qui fournit l’interface essentielle entre les individus et la société. La capacité à consommer définit le statut social, elle est le principal rapport qu’entretient le sujet libéral avec le monde. Les individus prétendent se construire, se définir et s’exprimer à partir de leur seule consommation. On appelle cette tendance le lifestyle, c’est-à-dire l’appropriation de contenus culturels et identificatoires mis en marché.
Nous pouvons établir un lien direct entre le consumérisme et le succès du temps réel propre aux nouvelles technologies. Pour réduire la durée d’un produit, le mieux est d’empêcher les consommateur·rice·s de consacrer trop d’attention à un même objet, il faut qu’il et elle soit impatient et irritable, qu’on puisse facilement éveiller leur désir et faire perdre rapidement leur intérêt. On assiste à une inversion du rapport traditionnel entre les besoins et leur satisfaction.
Le monde numérique repose sur l’immédiateté et la sursollicitation, l’excitation permanente, les notifications. L’individu devient impatient, irritable, n’arrive plus à se concentrer ni à prendre du temps, ouvert à tout mais incapable de se fixer sur rien. Il n’a plus d’instant à lui durant lesquels il pourrait développer une vie intérieure, un temps nécessaire à la construction de soi, à l’épanouissement et à la possibilité même de savoir vivre avec les autres.
Cette culture consumériste rejette tout apprentissage, érudition et accumulation, et rend immédiatement accessible une profusion de biens, d’informations, de données. Elle est une culture du désengagement, de la discontinuité et de l’oubli. Une autre caractéristique distingue cette société consumériste des précédentes : le brouillage voire l’effacement des distinctions entre marchandises et consommateur·ice·s. Pour être membres à part entière de cette société, les individus doivent eux aussi devenir des marchandises commercialisables, capables d’exister sur un marché.
Pour prendre l’exemple des sites de rencontres, l’utilisateur·ice y cherche une marchandise dont il ou elle va évaluer la qualité à partir de critères et de photos, et lui-même se présente comme une marchandise. Il ou elle est à la fois le consommateur·ice et le produit. Chacun·e se pense comme un objet valorisable sur un marché, désirable par rapport à la concurrence. On y retrouve les principes fondamentaux de la consommation de masse : abondance, liberté de choix, efficacité, rationalisation, ciblage sélectif, standardisation.
Le marché a écrasé tout ce qui l’a précédé. Le projet même du marché repose sur le principe d’individus « rationnels », c’est-à-dire sur l’hypothèse que chaque individu est égoïste, calcule constamment ses coûts et avantages avant chaque action, et que la somme de ces intérêts individuels mène au bonheur, c’est-à-dire la croissance. Une telle structure socio-économique ne repose que sur le pari d’un nombrilisme individualiste généralisé, souhaité et cultivé. Notre époque est toute entière tournée vers l’ego, il n’y a que le soi qui prévale, car c’est son expression qui permet au marché de fonctionner. Le capitalisme repose sur une dynamique d’innovation et de changement permanent. L’identité néolibérale se veut flexible et modifiable à l’envi, elle fait donc fi de toute tradition, enracinement et héritage sauf quand elle peut les intégrer à la sphère marchande.
Le consumérisme identificatoire est la façon dont capitalisme a su s’adapter et intégrer ses deux principales critiques, la critique artiste et la critique sociale :
- La critique artiste du capitalisme valorise la mobilité et le détachement de l’artiste dénonçant la marchandisation du monde qui produit le désenchantement, l’inauthenticité, la standardisation et la disparition de toute autonomie individuelle.
- La critique sociale tire ses racines du marxisme et considère le capitalisme comme source d’opportunisme, d’égoïsme et d’inégalités.
Le consumérisme de l’authentique est aujourd’hui une contradiction révélatrice du nouvel esprit du capitalisme. Les individus cherchent frénétiquement à se distinguer en consommant un bien qui échappait jusque-là au marché et qui est considéré comme « authentique ». Mais dès lors que ce produit est récupéré et investit par le marché, il perd sa qualité première recherchée justement par les sujets en quête d’authenticité. Le retour du petit artisanat dans les métropoles mondialisées, du handmade, obéit à cette même logique de quête de l’authentique, tout autant que le succès cynique des produits estampillés responsables, éthiques, bio, durables voire alternatifs ou pire, anti-système.
La marchandisation de l’alternatif et de l’authentique est un des plus grands obstacles au développement d’une pensée et d’une manière d’être au monde vraiment radicale (qui affronte les problèmes à leur racine). Le capitalisme absorbe et marchandise sa propre critique quand elle n’est pas suffisamment radicale. L’enfer du consumérisme est pavé de bonnes intentions de la croissance pour tous, nouvel ersatz de la colonisation occidentale.
 Retrouvez la première partie consacrée à cet ouvrage ici. On y parle de séries vidéos.
Retrouvez la première partie consacrée à cet ouvrage ici. On y parle de séries vidéos.
Le livre Divertir pour dominer 2 est disponible aux Éditions l’Échapée.
Vous pouvez aussi retrouver l’actualité d’Audrey Vernon sur scène avec son spectacle Billion dollar baby et suivre son nouveau podcast Big Books.
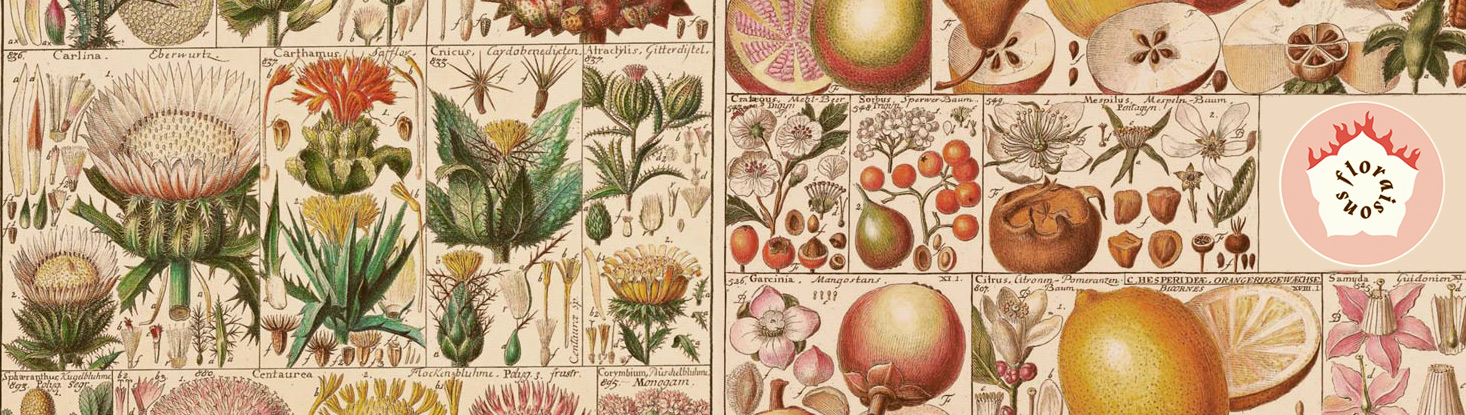


Adon
Posted at 11:57h, 23 avrilMerci pour le travail de partage et d’éclairage sur la société apportés par les podcasts.
Anonyme
Posted at 14:18h, 04 juilletÇa revient souvent, ce réflexe ou volonté d’ajouter un adjectif au capitalisme. Capitalisme moribond, exacerbé, etc. Ce sont des pléonasmes, le capitalisme se suffit à lui-même.
Damien
Posted at 01:13h, 09 octobretrès bien sauf… le chapitre qui parle du cinéma d’horreur, les films gores, le torture porn et vidéos propagande de Daech.
j’ai du écouter à plusieurs reprises, les phrases sont bizarrement tournées dans ce chapitre, comme non abouties. C’est assez troublant et un peu un raccourci de mettre un genre du cinéma dans le même sac que les films gores, torture porn et daech. un peu décevant alors que les deux podcast sont super bons. et par conséquent le livre est intéressant.