
Éduc spé au service des renseignements pénitentiaires 21 Avr 2021

TÉLÉCHARGER LE PODCAST
Floraisons a recueilli le témoignage d’un éducateur spécialisé qui a passé trois années dans l’Administration pénitentiaire. Il fait état d’une pratique qui a eu lieu entre 2016 à 2019. Même si aujourd’hui certaines pratiques ont pu éventuellement être changées, ce témoignage met en lumière les logiques de surveillance, de paranoïa et de rentabilité à l’œuvre dans les services de renseignements. Nous avons décidé d’anonymiser avec la participation d’un acteur pour la version podcast. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, et merci d’avance pour votre écoute. Je suis éducateur spécialisé depuis 10 ans et aujourd’hui je n’exerce plus cette fonction. Je ne l’exerce plus suite à 3 années passées à l’Administration Pénitentiaire. Voici mon histoire.
En 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier, et aux discours d’Emmanuel Valls du 21 janvier, le gouvernement met en place le PLAT, le Plan de Lutte Antiterroriste. Une première vague de recrutement est réalisée. Lorsque survient l’attentat au Bataclan, le 13 novembre 2015 je suis comme tout le monde surpris et assommé par cette nouveauté. Voilà qu’on s’attaque à « nous », pas à des journalistes politisés ou satyriques mais à « nous tous ». Un public de concert, à des personnes qui buvaient un verre en terrasse… À ce moment là je me mets à faire des recherches sur ce qu’il m’est possible de faire car comme beaucoup de citoyens à cette période, il y a cette envie de s’impliquer, de lutter, d’apporter son aide.
I. Je m’engage contre la « radicalisation »
Le travail d’éduc spé
Je tombe alors sur une offre d’emploi qui propose de lutter contre la « radicalisation » en tant qu’éduc spé dans les prisons pour laquelle je décide de postuler. L’éducateur spécialisé est amené à travailler auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des handicaps physiques ou mentaux, des troubles du comportement ou encore des difficultés sociales ou d’insertion. Il ou elle travaille en collaboration avec tous ceux qui participent à l’action éducative et sociale : psychologues, psychiatres, personnels administratifs, assistant·es de service social, enseignant·es, magistrat·es… Selon son lieu de travail, l’éduc spé peut exercer : en internat, en externat, en prévention spécialisée dans des quartiers etc…
L’éduc spé permet à une personne en difficulté d’agir sur elle-même et sur son entourage afin que sa condition sociale, éducative, psychique, matérielle ou de santé s’améliore. Il fait le pari de l’éducabilité de toutes et tous. En ce sens, pour l’éducateur spécialisé, l’avenir des personnes – pour et avec qui il mène une action éducative ou sociale – ne peut être condamnée du fait de leur passé, de ce qu’elles ont commis, ou de leur état de santé. Il agit avec la même conscience professionnelle, sans distinction aucune quels que soient leur origine, leur handicap, leur état de santé, leurs mœurs, leur situation de famille, leur appartenance à une ethnie, une nation, leur religion, leur opinion politique, leur orientation sexuelle, leur réputation, ce qu’elles représentent, les sentiments qu’elles peuvent éprouver à leur égard ou leur situation administrative de séjour en France.
C’est pourquoi en mars 2016 je prends mes fonctions au sein de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires en tant qu’éducateur spécialisé au sein d’un binôme Éducateur et Psychologue. C’est avec la conscience de toutes ces notions et une expérience de 7 ans dans diverses structures que j’envisage ma mission pour le PLAT, c’est-à-dire : agir avec les personnes pour aller vers le mieux. J’ai bien sûr, derrière cette idée, l’espoir que l’on me donne les moyens nécessaires à ce changement pour accompagner, aider les personnes détenues à s’envisager différemment. En tout cas c’est ce que je pense. J’imagine devoir aller chercher le meilleur, l’humanité, la compassion chez ces personnes pour espérer d’elles une autre façon de penser que la violence ou la « radicalisation ».
Premier formatage
D’ailleurs en parlant de « radicalisation » : que veut dire ce mot ? Il est nouveau pour moi et je l’entends partout, tout le temps, il devient confus, veut tout et rien dire, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne présage pas quelque chose de bon — le mot « radical » a plus tard pris un tout autre sens pour moi.
Lorsque je prends mes fonctions je dispose de deux semaines de formation, mais là, à ma grande surprise, rien dans cette formation n’est orienté vers la prise en charge de la « radicalisation », ou alors si peu, ou dans une optique si manichéenne qu’elle ne m’apporte rien. Le but de cette formation est plutôt de nous présenter un jargon, un cadre hiérarchique, des règles, des normes. En fait il s’agit d’une première étape de formatage pour nous faire adhérer à la doctrine du corporatisme d’État. À ce moment-là, alors même que je n’ai encore rien fait, j’ai déjà l’impression de faire partie de quelque chose de grand, d’une famille, de quelque chose d’utile pour la sécurité des citoyens, d’utile pour l’État, bref de gratifiant.
À l’issue de cette formation, j’intègre une équipe qui est en place depuis plusieurs mois et je me rends vite compte que pour le moment ils n’ont rencontré aucun·e détenu·e. Leur seul travail consiste à mettre en place leur arrivée sur le terrain et à se créer des outils — mais quels outils prendre quand on n’est jamais allé sur le chantier ? En fait jusque là rien ne s’était réellement passé. Les premier·es détenu·es “radicalisé·es” arrivent au mois de mars, presque en même temps que ma prise de fonction et je suis envoyé, sans attendre, en entretien avec des personnes avec pour seul bagage mes deux semaines de formation.
Ces premiers entretiens se déroulent dans ce qu’on appelle à ce moment une Unité Dédiée (sous-entendu dédiée aux personnes racialisées). Cette Unité est un bâtiment rattaché à un centre pénitentiaire mais de telle façon qu’il n’a aucun contact avec le reste de la population carcérale. En gros, c’est une sorte de ghetto pour les « radicaux » à l’intérieur même de la prison, avec une surveillance accrue de leurs faits et gestes. Cette Unité est censée accueillir des personnes signalées par différents services pénitentiaires comme étant dangereuses, réfractaires à un accompagnement (par un·e assistant·e social·e, le CPIP, le moniteur de sport, l’éducateur, etc) ou très prosélytes. On appelle prosélytes les personnes qui vont facilement faire adhérer les autres à leurs idées. On parle là du salafisme qui est un courant de l’islam sunnite. Globalement, personne n’est spécialiste des religions dans cette mission, mais beaucoup considèrent le salafisme comme dangereux car trop rigoriste et traditionaliste.
II. La réalité du terrain
Surveiller des personnes présumées innocentes
À l’origine, nous n’intervenons que sur des personnes reconnues comme « radicalisées ». Mais à ma grande surprise l’Unité où je suis envoyé accueille et mélange aussi des personnes prévenues. Pour rappel, un prévenu est une personne en attente de jugement ou pas encore condamnée. Ces personnes sont donc innocentes, puisque leur procès n’est pas encore passé et que leur culpabilité n’a pas été démontrée. Et pourtant elles peuvent être placée en détention provisoire le temps de l’instruction, l’enquête. Et une personne sous mandat de dépôt terroriste peut être incarcérée bien plus longtemps, jusqu’à quatre ans. Bien qu’elles bénéficient de la présomption d’innocence, ces personnes sont mises au contact des détenu·es reconnu·es coupables dans des affaires en lien avec le terrorisme islamiste.
Lorsque je suis en entretien avec mon ou ma collègue psychologue, nous faisons donc face à des personnes qui parfois ne sont pas encore jugées. Alors dans ce cas, comment aborder les faits ? La personne a le droit de refuser l’entretien, mais si elle accepte de nous parler, quid de ce quelle nous dira ? Prend-elle le risque de se mettre en difficulté pour son procès en venant nous parler ? Est-ce que je prends le risque d’incriminer une personne à qui je souhaite apporter de l’aide ? Mettons-nous à la place d’une personne détenue qui voit arriver des binômes qui les demandent en entretien. Elle peut très bien se demander « Qui sont ces binômes ? » et « Que veulent-ils ? ». Les premiers entretiens sont bien souvent le fruit de la curiosité des personnes détenues et peut-être de l’envie de
profiter d’une rare occasion de sortir un peu de leur cellule. Toujours est-il que nous voilà sans bagage ni formation en face de personnes parfois plus instruites que nous sur certains sujet, comme en géopolitique, en religion, sur les conflits internationaux, certaines connaissent même le front en Syrie. Bref il est assez compliqué en tant qu’éducateur à ce moment-là de pouvoir argumenter ou même d’alimenter la discussion. De ce fait nous abordons assez facilement les questions de la famille, de leur projet professionnel, de leurs environnements sociaux, activités… mais je pense que les personnes détenues s’attendent plus à des experts ou autre.
Compte-rendus écrits
Chaque entretien doit être, pour nous, suivi d’un compte-rendu écrit. Même si la personne interrogée n’est pas censée le savoir et que parfois nous avons eu l’ordre de mentir sur ce point, elle en a bien conscience. Les personnes détenues connaissent les rouages de l’administration pénitentiaire. Aucune parole ne peut réellement être confiée en détention. Certaines nous ont parfois soupçonnés de les enregistrer en entretien. En théorie nous n’avons pas le droit de le faire, mais dans la pratique notre équipe a déjà vu quelqu’un enregistrer un entretien, quelqu’un de plus haut placé que nous qui ne sentait a priori pas concerné par le règlement.
Ce qui est compliqué pour nous, lorsque nous nous penchons sur nos premiers écrits, c’est que nous ne savons pas vraiment ce que nous devons y faire figurer et surtout qui les lira. Évidemment si on me dit que mon document écrit ira au tribunal après sa validation, cet écrit n’aura pas la même teneur que s’il a seulement pour vocation d’être un document interne et de faire l’historique de la personne, afin de suivre son évolution par exemple. Le fait de ne pas savoir réellement où vont mes écrits me conduit à m’en tenir à des propos neutres. En effet, je ne veux pas que mes propres notes puissent avoir un quelconque impact sur l’avenir de la personne car je ne me sens pas légitime à émettre des jugements et à contribuer à l’établissement d’un profil. Voilà pourquoi je m’efforce de ne pas qualifier précisément la personne et je me contente d’émettre des hypothèses ou bien de rester vague dans mes propos.
De toutes façons, si le personnel a déjà un avis précis sur la personne que j’accompagne, je vais très difficilement le faire changer d’avis si je pense qu’il se trompe. Mes compte-rendus consistent plus souvent à aller dans le sens de l’administration en lui donnant les éléments nécessaires au profil à établir. Pour l’illustrer, imaginons que nous allons voir une personne considérée par l’administration comme très dangereuse — cet avis peut provenir des services de renseignements, du personnel de détention ou des faits pour lesquels elle est incarcérée — ou impliquée dans des faits très médiatisés qui ont couté la vie à de nombreuses personnes. Maintenant imaginons que nous disions très grossièrement dans notre compte-rendu :
« Cette personne nous semble non dangereuse en tant que telle mais potentiellement très manipulable et avec un niveau d’analyse assez faible. »
Ce pourrait être le cas d’une personne embarquée dans une histoire très sérieuse dont elle n’a absolument pas imaginé les conséquences avant qu’elle ne se produise. Quelqu’un qui ne sait pas anticiper. Cette personne seule ne représente pas la source des faits commis mais en devient actrice passive ou active qui agit sans connaissance de cause ou sans anticipation. Elle a pu être influencée voire manipulée par un groupe de personnes avec des objectifs précis.
Si ce compte rendu est proposé comme tel à l’administration, il va néanmoins être très compliqué pour certains de nos partenaires de penser que cette personne est réellement telle que nous l’avons décrite. L’administration peut toujours douter et imaginer que la personne interrogée « joue à un petit jeu » et qu’elle tente de nous manipuler. Certes, nous ne pouvons jamais rien affirmer à 100%, nous travaillons à partir de ce que la personne nous dit, mais considérer par défaut la personne détenue comme menteuse et manipulatrice ne l’amènera surement pas — si c’est effectivement le cas — à changer.
Un accompagnement impossible
À ce moment-là il me parait évident que ce qu’il me manque, c’est le partage de la vie quotidienne avec la personne que j’accompagne, comme j’ai pu le vivre dans d’autres institutions, des moments de tous les jours qui nous permettent de comprendre. Il n’y a rien de mieux que de voir évoluer la personne dans son environnement quotidien, face à ses problèmes, s’adresser, échanger avec les autres, se comporter au sein d’un groupe, etc. Pour rendre ça possible, il faudrait se détacher du fonctionnement en binôme et proposer à notre hiérarchie une mission avec des détenu·es à accompagner, tout en restant entre les murs de la prison. Mais je sais au fond de moi que la posture de l’administration ne va pas dans ce sens et je n’ai même pas le courage de faire cette proposition à ma hiérarchie. Nous avons plusieurs fois évoqué entre collègues que l’essence même de l’éduc spé est d’agir seul en proximité avec les personnes, et non pas de les recevoir constamment dans le cadre d’un entretien, dans une salle de 5m2 avec trois chaises et un bureau…
Finalement la place au « social » et à la psychologie est assez faible puisque nous ne sommes là que pour de courtes durée, un entretien dure une heure environ. Nous ne sommes jamais dans le quotidien des personnes détenu·e·s. Même les éducateurs et psychologues résidant dans les Unités Dédiées n’y sont que pour leur journée de travail, entrecoupée d’entretiens, de réunions et pour des activités ciblées. La majeure partie du temps, les détenu·es côtoient plutôt les murs de leur cellule, leurs co-détenu·es — quand ils en ont un ou une — et les matons, des bourreaux qui représentent et maintiennent un système punitif et répressif et qui pensent que la plupart des prisonnier·es méritent l’enfermement et la privation de libertés. À partir du moment où le système judiciaire vous a considéré comme coupable et vous envoie en prison, la société, le public, le personnel pénitentiaire et parfois même vos proches vous catégorisent comme « nocif » et « répréhensible » uniquement. Ceci est valable durant la peine mais également au moment de la sortie, ce qui explique en partie la récidive.
À plusieurs reprises les personnes détenues nous demandent où vont ces compte-rendus écrits, et nous sommes incapables de répondre véritablement. Par la suite nous leur proposons de relire nos documents pour qu’elles puissent vérifier que leurs propos n’ont pas été déformés. Elles peuvent éventuellement les modifier, le risque étant d’avoir un lissage, une aseptisation des propos. Où vont nos écrits ? Qui les lit ? Est-ce qu’ils apparaissent dans le dossier des personnes détenues consultable par n’importe quel professionnel pénitentiaire ? Toutes ces questions restent en suspens, et elles le resteront encore après mon départ en 2019.
III. L’esprit carcéral
Catégoriser pour surveiller
Chaque entretien est plus ou moins préparé. Nous assistons à des réunions d’équipes appelées CPU (Commission disciplinaire Unique). Ces réunions regroupent divers corps de métiers, CPIP (Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), Chef d’établissement, Surveillant, Chef de bâtiment, Psychologue et nous-mêmes. C’est l’occasion pour les équipes de faire le point sur les situations des personnes. Pour nous c’est la possibilité de recueillir des informations, puisque nous ne connaissons pas la personne en dehors du cadre de nos entretiens. Pour surveiller efficacement certaines personnes, il faut que ces dernières l’ignorent au maximum. Il arrive que le personnel de la prison préfère surveiller discrètement une personne et estime que le fait de recevoir une convocation pour un de nos entretiens lui mettrait trop la puce à l’oreille, voilà pourquoi dans certains cas nous ne sommes pas autorisés à la rencontrer.
Des grilles de « détection de la radicalisation » sont mises en place pour les « professionnels encadrant la population carcérale ». Ce sont des suggestions de comportement avec des cases à cocher comme « oui » ou « non » qui reposent sur des grilles très binaires et fondées sur des observations très discutables. Voilà ce que l’on peut trouver sur une grille de détection :
- Est ce que le détenu à une télé dans sa cellule ?
- Est ce que le détenu dort sur son lit ou au sol ?
- Est ce que le détenu serre la main aux femmes ?
- Est ce que le détenu adresse la parole aux surveillants ?
- Est ce qu’il porte une tenue traditionnelle ?
- Est ce que le détenu a un Coran ou d’autres livres religieux dans sa cellule ?
- Est ce que le détenu fait sa prière ? etc….
Ensuite le personnel transmet toutes ces observations à sa hiérarchie qui décide alors de catégoriser la personne dans la case « radicalisé » ou « non radicalisé ». Il arrive aussi que la Direction Interrégionale nous envoie interroger une personne juste pour vérifier si celle-ci se radicalise ou pas. Cela peut parfois perturber la personne détenue qui subit alors un « traitement spécial » par l’équipe du personnel pénitencier au sein de sa prison — une surveillance plus accrue de ses faits et gestes, des rendez-vous avec notre binôme, des fouilles de cellules plus fréquentes, etc. — alors qu’elle estime n’avoir rien fait d’illégal.
Entre la prison et les Renseignements
Les vagues médiatiques et les différents évènements liés aux radicalisme islamique peuvent avoir des répercussions sur notre métier. Par exemple, lors des attentats de Nice le 14 juillet 2016, certaines personnes détenues ont crié de joie à leur fenêtre, ou ont lancé un « Allahu Ahkbar ». De ce fait, nos différents partenaires au sein des établissements pénitentiaires et ceux du SPIP en milieu ouvert (Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation) nous ont envoyé plusieurs demandes pour des entretiens. Chaque prison ou SPIP craint que de nouvelles personnes se radicalisent, peut-être par peur d’une recrudescence de l’islamisme, mais je pense aussi que certains chefs d’établissements ne souhaitaient pas avoir de détenus dits « radicaux » puisque cela implique des protocoles de surveillance particuliers et l’arrivée d’intervenants extérieurs pour les évaluer. Parfois dire que tout va bien est bien plus simple.
C’est pourquoi parfois la CIRP (Cellule Interrégionale du Renseignement Pénitentiaire) nous interpelle afin d’aller voir une personne détenue suspectée de « se radicaliser ». Le problème alors se situe au niveau du signalement. C’est-à-dire que nous ne pouvons pas aller voir une personne si rien ne nous indique qu’elle est potentiellement « radicalisée ». Si nos informations ne proviennent pas de l’administration pénitentiaire, c’est qu’elle proviennent des services du renseignements, mais la source doit rester secrète pour que le renseignement puisse fonctionner. Dans ces conditions, comment faire face à une personne détenue en lui expliquant le motif de notre entretien sans éveiller les soupçons qu’ elle est surveillée par les Renseignements ? Nous devons donc trouver des prétextes alambiqués pour aller voir cette personne, et nous voilà de fait entre deux services : celui du PLAT et celui du Renseignement Pénitentiaire, et donc avec des informations sensibles.
Tout est suspect
La question des livres est très sensible lorsque l’on parle de radicalisation et d’actes extrémistes violents en détention. Il n’est pas rare que les livres circulent entre personnes détenues et certains ouvrages inquiètent plus que d’autres le personnel. Les livres ne sont cependant pas interdits et on peut s’en faire remettre de l’extérieur par un proche lors d’une visite parloir. Il suffit que le livre soit référencé avec un code ISBN pour que celui-ci soit admissible en détention. Autrement dit il n’y a aucune raison qu’un livre soit interdit ou soit confisqué si celui-ci à un dépôt légal, mais dans les faits ce n’est pas la même chose. Un des ouvrages les plus répandus et qui est parfois confisqué c’est La Citadelle du musulman de Shaykh al- Qahtânî. Il s’agit d’un ouvrage comprenant des invocations tirées du Coran, un ouvrage que l’on trouve en vente libre à la Fnac ou ailleurs. Bref c’est loin d’être un livre qui se trouve sur le marché noir, et pourtant… Il est parfois confisqué à quelqu’un lors de son arrivée dans la cellule.
Si vous êtes musulman·es et féru·e de lecture – qui plus est religieuse – vous avez le profil parfait d’un·e prosélyte. Si vous êtes religieux et que vous demandez à passer le permis poids lourds alors vous avez le profil idéal d’une personne qui souhaite reproduire les attentats de Nice. Si vous faites des études de psychologie en détention, vous avez le profil d’un manipulateur voir d’un recruteur. Et enfin si vous ne faites rien mais que vous êtes religieux, que vous ne faites pas de vague, que l’on n’entend jamais parleer de vous alors c’est louche, vous avez potentiellement le profil d’une personne qui s’isole et qui pourrait se préparer à un attentat suicide à sa sortie. Si toutefois vous avez le profil du « détenu parfait », que vous avez trouvé un logement, un travail, que votre conduite était exemplaire mais que vous avez des antécédents de violences ou un lien avec le terrorisme ou des personnes radicalisées, c’est que vous souhaitez vous fondre dans la masse pour pouvoir agir en sous-marin. Du point de vue de l’administration et des Renseignements, les personnes détenues ne sont presque jamais considérées autrement qu’à travers les faits qu’elles ont commis ou qu’elles pourraient commettre.
Je deviens paranoïaque
Au cours de mes trois années en poste je vais bénéficier d’une formation à L’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) sur les enjeux du terrorisme, ses stratégies, ses tactiques, etc. À cette occasion nous pouvons y voir l’évolution des techniques de propagande de L’État Islamique, les stratégies tactiques et militaires adoptées par les combattants etc. Cette formation est animée par des magistrat·es, le parquet anti-terroriste, des membres de la DGSI et DGSE ainsi que d’autres intervenant·es comme des enseignants-chercheurs spécialisé·es dans le Moyen Orient.
Cette formation est surtout à destination des magistrat·es mais quelques places sont aussi attribuées à l’administration pénitentiaire et elle a un très fort impact sur moi. J’en ressors complètement paranoïaque. À ce moment là je me trouve à Paris et pour regagner mon hôtel je n’ose plus utiliser les transports en communs. J’ai peur. Ce n’est pas d’une personne en Hijab ou portant une barbe dont j’ai peur – ça c’est l’image façonnée par les médias sur l’islamisme radical. En fait j’ai peur de tout le monde, toute personne peut être suspectée et soupçonnée d’exercer la Taqiya, c’est-à-dire de se dissimuler. Si une personne qui semble être « comme tout le monde » devient suspecte, alors tout le monde est suspect. Mes comportements changent, je ne prends que des taxi Uber dans lesquels je suis seul, je privilégie les bus avec très peu de monde au métro en me disant qu’avec peu de passagers ce serait une mauvaise cible pour un attentat.
Puis peu à peu, au fil des jours, le choc de la formation se dissipe et je recommence à utiliser le métro normalement. Je pense que les stigmates de cette formation sont derrière moi ; jusqu’au jour où je me trouve dans une rame de métro pleine de monde, et une personne qui monte me semble suspecte. Immédiatement, je lui attribue de mauvaises intentions, sans même lui adresser la parole. Je suis persuadé que cette personne va passer à l’acte, elle va se faire exploser d’un moment à l’autre, c’est sûr. Plus j’y pense, plus l’angoisse monte et ce sentiment parait prémonitoire. Mille questions se posent dans ma tête.
« Est-ce que je dois alerter tout le monde ? Mais dans ce cas, est-ce que je m’appuie sur un mauvais pressentiment ? Je pourrais être accusé d’avoir créé un mouvement de panique en suspectant une personne inconnue… Mais si je sors de la rame sans prévenir personne et que j’ai vu juste, alors tout le monde sera exposé et je serai coupable de n’avoir rien dit… Pire, est-ce que je me serais extirpé comme une personne égoïste ? »
Je décide d’attendre et de rester dans le wagon jusqu’au moment où je réalise que je me situe à quelques arrêts de la gare des trains. Cette jonction représente pour moi le lieu idéal pour passer à l’acte puisque qu’il y a beaucoup d’affluence en heure de pointe. Je sors alors quelques arrêts avant, accompagné d’un énorme sentiment de culpabilité, pour m’apercevoir quelques minutes plus tard qu’aucun incident n’a eu lieu sur cette ligne et que je m’étais trompé tout du long.
Ce moment est très important pour moi, parce que je me rends compte que je suis également tombé dans une paranoïa lors de mes entretiens. Tous les dires, faits et gestes de la personne sont vus d’abord sous le prisme de la mauvaise intention et non comme un acte, ou une parole anodine.
Influences politiques et médiatiques
Comme je le disais précédemment chaque fait médiatique en lien avec la radicalisation peut avoir des répercussions directes sur notre métier. Après l’agression d’un surveillant dans une Unité Dédiée à Osny en novembre 2016, Le Ministre de la Justice, à l’époque Jean-Jacques Urvoas, annonce la fermeture des Unités Dédiées et priorise la sécurité du personnel pénitentiaire. Je me souviens qu’à ce moment-là nous étions au travail et nous apprenons ça sur Twitter. On s’est tous et toutes regardées en se demandant ce que nous allions faire, si notre poste allait disparaître ? Et si tout le travail fait avec les personnes allait s’arrêter subitement ? Finalement quelques jours plus tard nous apprenons qu’il s’agit d’un effet médiatique et que les Unités Dédiées ne fermeront pas mais changeront d’appellation.
Ces changements d’appellation sont survenus plusieurs fois. Il ne s’agit malheureusement pas que de changer des noms, puisque pour changer de noms et éventuellement modifier légèrement le fonctionnement, il faut des tas de réunions, de paperasses, de rassemblement de cadres. Tout ça est surtout politique mais amène le personnel à être constamment dans une espèce de confusion, se demandant à chaque fois ce qui allait encore changer, ce que cela allait impliquer sur les tâches de travail. Le personnel est parfois consulté mais cela vaut pour des raisons de politesse plus que fonctionnelles puisque leurs revendications sont très peu acceptées ou alors juste assez pour éviter l’indiscipline. Si une revendication est prise en compte par l’Administration pénitentiaire, c’est qu’elle a été suggérée par quelqu’un qui sait déjà à l’avance qu’elle ne va pas contre les intérêts des membres de l’assemblée. En d’autres termes rien dans ces revendications ne permettra de remettre en cause le fonctionnement de l’Administration.
Une administration patriarcale
Cette administration est principalement constituée d’hommes. J’ai vu ma collègue remettre plusieurs fois à leur place les hommes, qu’ils soient détenus ou faisant partie du personnel, au sujet de remarques déplacées, de blagues sexistes. La façon dont une femme est traitée par les hommes ne dépend pas de son statut hiérarchique car de nombreuses femmes avec des postes à responsabilités subissent ces remarques, et le fait d’être plus gradée amène souvent ces réflexions à se faire dans leur dos.
L’administration pénitentiaire est soumise au code vestimentaire de l’uniforme. Les personnes sans uniforme sont plus rares en détention que les personnes qui le portent, et les femmes sont minoritaires. Les éduc spé n’ont pas à mettre d’uniforme et je peux vous garantir que les remarques ou les regards sur les tenues, le maquillage, les chaussures portées, les jupes plus ou moins courtes, les pantalons plus ou moins serrés, sont fréquentes. Les femmes doivent constamment réfléchir à leur apparence, essayer de contrôler leur réponse pour ne pas vexer les hommes. Elles doivent accepter pour ne pas être mises de côté.
Ces réflexions sur l’uniforme et sur cette volonté à vouloir être comme les autres m’amènent à dire que l’administration pénitentiaire fait corps, il y a cette pensée unique liée aussi à l’obéissance hiérarchique. On ne questionne pas les ordres, on applique. Cette uniformisation de la pensée se façonne à plusieurs endroits selon moi. La première phase – que je n’ai moi-même pas eu à subir pour prendre mes fonctions – se passe à l’Enap (École Nationale de l’Administration Pénitentiaire). Le passage à l’Enap dure 8 mois et se fait sur un campus assez isolé dans lequel chacun dort dans une chambre ressemblant de près à une cellule et que les stagiaires partagent généralement avec une autre personne. C’est aussi un passage où l’on soude les liens de « la grande famille de l’administration pénitentiaire », où on a l’impression de faire partie d’un groupe, d’une communauté. C’est cela qui permet d’accepter plus de maltraitance de la part de la hiérarchie.
J’ai ressenti cette administration comme patriarcale mais aussi très infantilisante. Il faut savoir que même si la hiérarchie a tort, elle a quand même raison et si vous la contrariez alors vous serez sanctionné·es. L’Administration Pénitentiaire ne fait confiance qu’à son propre fonctionnement. Je me demande comment les personnes détenues peuvent être « accompagné·es » par des personnels malmenés. Ce passage est crucial à tel point que plus tard, lors de mon non-renouvellement de contrat, ma hiérarchie me reprochera de ne pas rentrer dans le rang et dira que la phase de formatage de 8 mois à l’Enap m’aurait fait le plus grand bien. Cette remarque me permettra de comprendre que c’est que ma remise en question des consignes — en fait des ordres — et ma volonté de chercher des explications qui me valent d’être catalogué comme indiscipliné, voire insolent. Cette remarque renforcera plus encore ma volonté de départ
IV. Un travail absurde
Logique de rentabilité
Pour l’Administration Pénitentiaire, les raisons, les causes, les explications importent peu comparé à toutes les données qui peuvent être médiatisées comme des réussites : la baisse du nombre de personnes « radicalisées », l’augmentation des personnes suivies de très près etc. Or dans mon métier d’éduc spé, on cherche à connaitre le parcours des personnes. On ne cherche pas à leur trouver des excuses sur des actes commis mais plutôt à en trouver le cheminement. Comment en sont-elles arrivées là ?
Lors de mes débuts dans ce poste nous sommes libres de choisir quand mettre fin au suivi d’une personne. C’est-à-dire qu’au bout d’un certain nombre d’entretiens nous pouvons décider que le suivi est satisfaisant, et nous pouvons alors faire un relais avec une autre équipe de professionnel·les ou bien décider de stopper le suivi avec cette personne. Et puis un jour, ce fonctionnement change, notre service nous demande de faire une évaluation des personnes sur trois entretiens maximum. Ce jour-là je vois à l’œuvre une vraie logique de rentabilité de notre temps passé en entretien, il faut aller au plus vite à la recherche d’informations, quitte à en oublier le lien créé, l’adhésion de la personne. Quid d’une personne qui ne vient qu’à un seul entretien? Ce qui compte surtout au final, c’est que la personne soit classée soit comme dangereuse / inoffensive / prosélyte / influençable / avec un profil de leader…
Au service des Renseignements
Au fil du temps je m’aperçois même que beaucoup de nos partenaires ne s’attardent que sur la conclusion de notre compte-rendu écrit — quand ce n’est pas la seule partie qu’ils ont lu — faisant fi de nombreuses nuances ou d’explications majeures. Je vois aussi circuler des passages de nos écrits, extraits de leur contexte. C’est évidemment très problématique, isoler une phrase ou une conclusion d’un compte rendu revient à faire un énorme raccourci et ceux-ci peuvent être utilisés à mauvais escient, avec des conséquences terribles sur les vies des personnes.
À la base, je me suis engagé pour faire ma mission d’éduc spé et aller chercher le meilleur et l’humanité chez les personnes accompagnées. Mais de mon point de vue, en nous engageant nous sommes devenu·es des membres du Renseignement Pénitentiaire, non pas parce que nous en avons le statut officiel ou que nous faisons partie du service de renseignement, mais parce que les documents que nous produisons sont vus uniquement sous cet angle. C’est quelque chose que je n’ai pas du tout envisagée en postulant à ce poste et j’ai pourtant accepté petit à petit de prendre cette position. On se convainc de l’intérêt sécuritaire de cette mission, que notre rôle est nécessaire à cette tâche et surtout que cette dernière participe à la sécurité de nos concitoyen·nes.
Toutes les informations que nous récoltons et mettons en forme sont recoupées ensuite avec d’autres données émanant du personnel en détention carcéral, de la famille des détenu·es, de partenaires extérieurs, etc. En gros lorsque vous êtes suivi·e pour « radicalisation » il y a très peu de chance pour que tous vos faits et gestes ne soient pas rapportés, surveillés et interprétés. Si vous parlez arabe au téléphone avec votre famille ou d’autres détenu·es, c’est certainement que vous ne voulez pas être compris·e donc vous cachez potentiellement quelque chose. On pourrait envisager un usage affectif de la langue arabe, ou une façon de se rapprocher de quelqu’un, mais tout, même l’intime, devient sujet à suspicion, interprétation, classification.
Une organisation incohérente
Ce que je raconte ici dans mon témoignage concerne la Direction Interrégionale dans laquelle j’ai travaillé mais pas forcément les autres, car chaque Interrégion n’a pas nécessairement le même fonctionnement. Au moment de mes fonctions, des directives nationales sont formulées par la DAP (Direction de l’Administration Pénitentiaire) mais ensuite chaque DI (Directeur Intérregional) applique ses directives selon son bon vouloir ou divers intérêts. Rien n’est harmonisé, et cela s’applique dans tous les domaines, même celui des Ressources Humaines, les contrats, les payes, le rattachement administratif ou bien la localisation des équipes.
Certaines DISP (Direction Interrégionale du service Pénitentiaire) font des équipes sur chaque antenne du SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) quand d’autres les rattachent à La DISP. Certaines équipes sont rattachées au DSD (Département Sécurité et Détention), ce qui traduit une approche de sécurité et renseignement puisque c’est ce service qui gère aussi le renseignement. D’autres encore sont rattachées à un DFSPIP (Directeur Fonctionnel des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation) qui endosse une casquette plus « sociale ». Dans certaines régions, lorsqu’il s’agit de personnes avec des contraintes judiciaires uniquement ou des aménagements de peines, des binômes sont autorisés à des entretiens à domicile, mais certaines DISP refusent cette approche. Certain·es d’entre nous sont autorisé·es à voir les personnes seules en rendez-vous, d’autres ne sont autorisé·es à travailler qu’en binômes. Cette hétérogénéité de fonctionnement renforce encore plus le sentiment d’incohérence de la mission. Elle démontre aussi à quel point l’administration est incapable de suivre un ordre de façon harmonisée, ce qui est très paradoxal vu ce qu’elle exige de la part de ses employé·es.
Démission
Durant mes trois années en fonction, je suis témoin d’un énorme taux de renouvellement dans notre équipe et bien souvent pour des raisons qui sont les mêmes à chaque départ. Ces raisons ayant été remontées plusieurs fois à notre hiérarchie et pourtant cette dernière ne trouve jamais bon de se remettre en question afin de créer l’adhésion au poste. Ces raisons sont :
- Le manque de sens dans notre mission, notre parole de travailleur social peu prise en compte.
- Le salaire très bas, ancienneté et qualification non reconnue (même après 40 ans d’expérience).
- La difficulté à rentrer dans le « moule » sécuritaire de la Pénitentiaire
- La difficulté éthique et morale face aux demandes de la mission et la divergence entre ce pour quoi nous avons cru postuler au départ et la réalité de notre travail.
Dans mon cas, je suis tenu de recevoir les personnes uniquement accompagnée d’un·e psychologue, sauf cas très exceptionnels. Il en est de même pour mon ou ma collègue. La rédaction des document doit aussi être réalisée ensemble et uniquement ensemble. Je ne rédige jamais en mon nom propre un compte- rendu. Le problème de ce fonctionnement est qu’il faut parfois trouver un consensus, voire s’effacer ou s’imposer face à l’idée de l’autre. Ceci pose donc forcément un problème dans le document écrit produit. Admettons que nous ne soyons pas du tout d’accord sur la personne… Nous finissons parfois par produire des documents qui contiennent deux parties, celle de l’éducateur et celle de la psychologue. Ces écrits peuvent alors rentrer en contradiction quand éducateur et psychologue ont des conclusions différentes.
Même si j’ai trouvé le moyen de travailler avec les personnes, j’ai compris assez rapidement que ce n’est pas l’objectif premier de ma mission : il s’agit tout d’abord « d’évaluer les risques » chez ces personnes. À la fin, une personne détenue m’interpelle en me disant: « Vous êtes bien éducateur ? Alors en quoi vous allez pouvoir nous aider aujourd’hui ? » À ce moment là, je peux jouer la carte de l’hypocrisie et tenter de mettre en place un outil pour la contenter mais, ne croyant plus du tout à ce que je fais, je n’en ai ni l’énergie ni l’envie. Je ne veux plus faire semblant. Je lui réponds que ma mission n’est pas de l’aider. À cet instant précis une réelle rupture avec mon métier se fait sentir et je sais que c’est définitivement fini pour moi.
Lorsqu’enfin je décide de quitter mes fonctions, je repars avec l’intime conviction que l’enfermement d’une personne n’est pas une solution et encore moins quand aucune autre perspective ne l’accompagne. Son esprit, sa réflexion, sa capacité à s’ouvrir sur l’extérieur, à adhérer au fonctionnement de la société ne fait que s’étioler pour finalement créer un rejet de celle-ci. Je ne dis pas qu’aucune personne ne peut espérer une « insertion sociale » facile après un séjour en prison mais les chances sont minces — comme le prouve le nombre de récidives —, il est difficile de sortir indemne de ce monde violent, maltraitant, sécuritaire, militaire et infantilisant.
Durant mon parcours dans le service du PLAT, mes collègues et moi-même avons également proposé de suivre d’autres personnes en lien avec la « radicalité ». Nous voulions élargir le spectre comme certain·es de nos collègues l’ont fait avec des indépendantistes basques par exemple. Le but était d’étendre nos missions à toute forme de contestation violente. Cela pouvait s’adresser aux groupes féministes, aux groupes écologistes, ou groupes d’extrême droite, et bien d’autres encore, du moment que ceux-ci utilisent la violence comme moyen de se faire entendre. Ce projet a très vite été écarté pour nous. Notre direction interrégionale nous a répondu que la priorité du moment était le terrorisme islamiste mais que l’idée pouvait être conservée si le focus médiatique est plus tard fait sur d’autres groupes considérés comme « terroristes », allant contre les principes de la laïcité, de l’État et de son fonctionnement. Tout ceci est bien sûr justifié par la volonté d’assurer la « sécurité publique ».
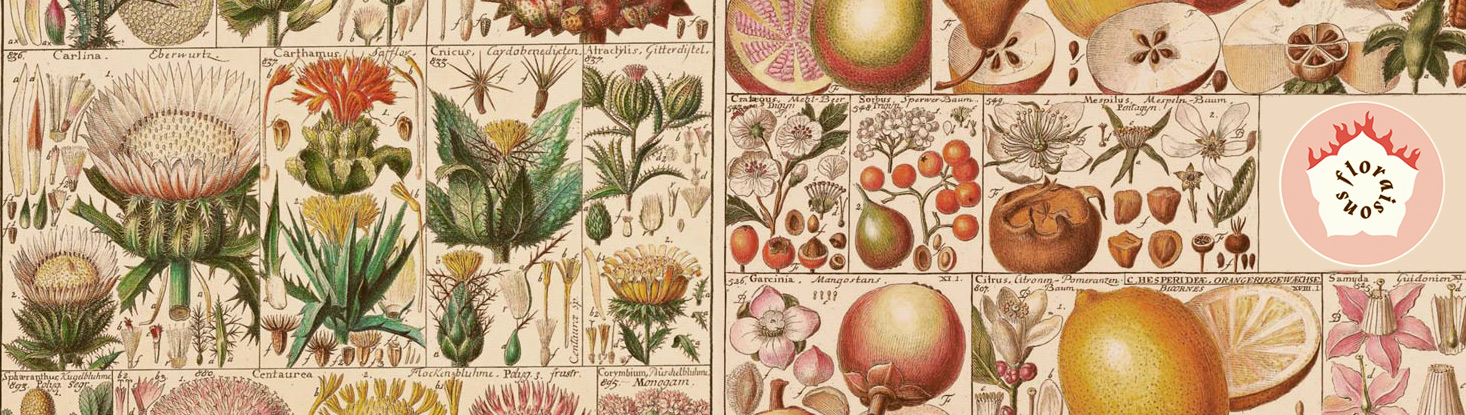


Pingback:Khrys’presso du lundi 26 avril 2021 – Framablog
Posted at 07:47h, 26 avril[…] Éduc spé au service des renseignements pénitentiaires (floraisons.blog) […]
Johnny
Posted at 21:23h, 21 maiTrès complet, encore une fois !
Océ
Posted at 11:32h, 29 janvierMerci pour cette transparence, article très interessant. Dommage que ce soit anonyme. car j’aurai bien parlé avec vous.
Je voudrais travailler en prison, etant éduc aussi, mais j’ai mes reserves.. Tout ce que vous dites confirme mes croyances.